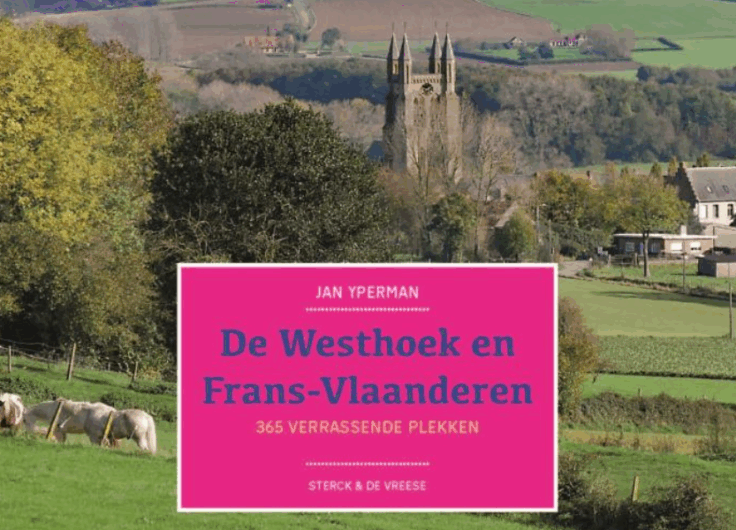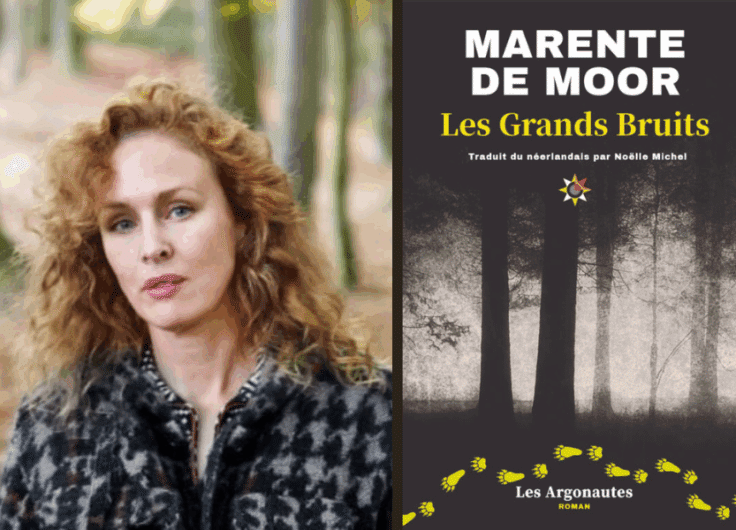Humainement reconnaissable et mystérieux par manipulation : continuons à regarder Pieter Bruegel
Où se trouve la clé de la magie que Pieter Bruegel l’Ancien continue à exercer sur nous? Comment devons-nous regarder ses toiles et que devons-nous penser des mythes dont son œuvre fait l’objet?
Je
suis un garçon d’une dizaine d’années. Mon père est lui-même
un artiste et sa bibliothèque croule sous les livres d’art. Je lui
demande si je peux feuilleter ce gros livre encore une fois. Il est
souvent hasardeux de reconstituer des souvenirs, mais je suis quasi
certain que la vision de toutes ces toiles et de toutes ces images
suscitait en moi une forte impression de déjà-vu. À l’époque
déjà, j’étais captivé par le phénomène qui hante parfois les
spécialistes de Bruegel: cette œuvre est à la fois insaisissable
et reconnaissable, et cette remarquable combinaison peut susciter
chez l’observateur l’impression qu’il est initié, qu’il
comprend de quoi il s’agit.
«La nature fit un choix singulièrement heureux le jour où elle alla prendre, parmi les paysans d’un obscur village brabançon, le spirituel et truculent Pierre Bruegel pour en faire le peintre des campagnards.»
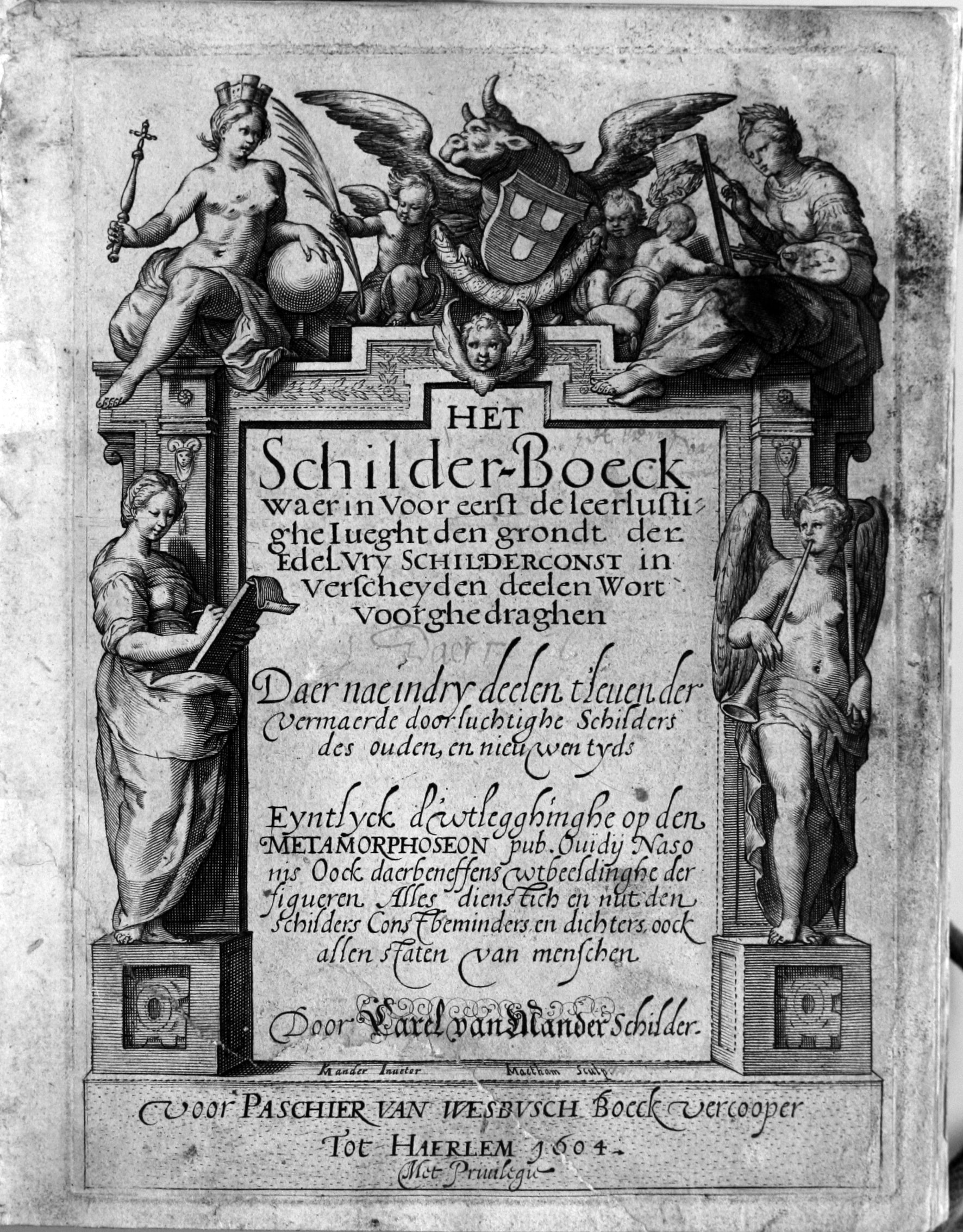
Voilà comment débute la
première description de Pieter Bruegel l’Ancien qui ait été
confiée au papier. Elle figure dans le Schilderboeck
(Le Livre des peintres) de Karel van Mander, paru en l’an 1604,
soit trente-cinq ans après la mort de Bruegel, et tout le portrait
biographique dont elle fait partie continue sans doute de diriger le
regard que nous portons sur ce peintre déroutant.
En
fait, Bruegel et les travaux qui lui sont consacrés peuvent être
considérés comme un phénomène du XXe
siècle. Bien qu’il ait encore fait l’admiration de plusieurs
générations après sa mort, son œuvre ne sera plus guère
appréciée au cours des XVIIIe
et XIXe
siècles et tombera dans l’oubli, à un point tel que les marchands
d’art ou les collectionneurs ne feront plus vraiment la distinction
entre son œuvre et celle de ses fils, Pieter Bruegel le Jeune (dit
«Bruegel d’Enfer») et Jan Bruegel (surnommé «Bruegel
de Velours»).
Fritz Mayer van den Bergh fait l’achat de sa vie
À
cet égard, l’histoire de l’achat du
chef-d’œuvre Margot la Folle
est révélatrice. À l’automne de 1894, Fritz Mayer van den Bergh,
un collectionneur d’art allemand qui habitait à Anvers, apprend
par l’historien de l’art Max Friedländer que la maison de vente
Heberle de
Cologne pourrait bien avoir une offre intéressante. La peinture
numéro 48 au catalogue est décrite comme une «représentation
fantastique d’un paysage avec de nombreuses figures
fantasmagoriques» et il est précisé qu’elle est sans doute de la
main de l’un des fils de Pieter Bruegel l’Ancien. La toile est
exposée temporairement tout en haut d’un mur. Friedländer a
besoin d’une échelle pour pouvoir l’examiner de près. Très
intrigué par le commentaire enthousiaste de l’historien de l’art,
Fritz Mayer ordonne à son agent d’acheter la toile le 5 octobre
1894, ce qu’il fait pour la très modique somme de 488 francs
belges, à une époque où il faut débourser des dizaines de
milliers de francs pour une œuvre de Rubens.
 Pieter Bruegel l'Ancien, «Margot la Folle», huile sur panneau, 117,4 x 162, 1563, «Museum Mayer van den Bergh», Anvers
Pieter Bruegel l'Ancien, «Margot la Folle», huile sur panneau, 117,4 x 162, 1563, «Museum Mayer van den Bergh», Anvers© KIK-IRPA, Bruxelles.
Peut-on s’imaginer le choc que Fritz Mayer
ressent lorsque cette toile arrive enfin à Anvers et est déballée
devant lui? Il se retrouve tout à coup face à un panneau de la main
non pas de Pieter Bruegel le Jeune, mais de son père, le fameux et
mystérieux Pieter Bruegel l’Ancien. C’est que le collectionneur
connaît ses classiques. Dans son Livre
des peintres, Van Mander évoque un
tableau qui se trouve à ce moment en possession de Rudolphe II
à Prague et qu’il décrit comme «une folle Marguerite, en train
de recruter au profit de l’enfer, elle semble égarée et son
accoutrement contribue à cet aspect terrible». Fritz Mayer van den
Bergh a fait l’achat de sa vie.
Ce moment pourrait être considéré comme l’un
des tout premiers événements clés des études bruegeliennes, et il
est symptomatique que les mots de Van Mander permettent
l’identification de l’une des œuvres cruciales de Bruegel près
de trois siècles après qu’il les a écrits.
Bruegel,
«l’un des nôtres»
Au
cours de la première moitié du XXe
siècle, les études bruegeliennes se succèdent. Tout à coup,
Bruegel intéresse aussi bien les historiens de l’art que les
auteurs littéraires. Un auteur flamand aussi populaire à l’époque
que Felix Timmermans est véritablement touché par le virus de
Bruegel au cours des années 1920. En 1928, il publie Pieter
Bruegel – zo heb ik u uit uw werken geroken, que
l’on pourrait traduire littéralement par «Pieter Bruegel – voilà
comment je vous ai senti dans vos œuvres», un superbe titre qui
m’émeut autant qu’il me fait rire.
 Pieter Bruegel l'Ancien, «Le Repas de noce», huile sur bois, 114 x 164, 1568, détail, «Kunsthistorisches Museum», Vienne.
Pieter Bruegel l'Ancien, «Le Repas de noce», huile sur bois, 114 x 164, 1568, détail, «Kunsthistorisches Museum», Vienne.Dans
ce livre, Timmermans décrit les sentiments que le peintre suscite
dans son cœur d’écrivain et l’introduit dans son propre monde,
lequel s’articule autour de la simplicité et de l’humour de la
vie paysanne. L’idée n’est pas saugrenue puisqu’à cet égard
également Karel van Mander nous montre l’exemple, en évoquant la
fascination que la vie paysanne exerce sur Bruegel. Avec son ami Hans
Franckert, raconte Van Mander, le peintre assiste à des noces
paysannes pour y trouver l’inspiration: «À deux, Franckert et
Bruegel prenaient plaisir à aller aux kermesses et aux noces
villageoises, déguisés en paysans, offrant des cadeaux comme les
autres convives et se disant de la famille de l’un des conjoints.
Le bonheur de Bruegel était d’étudier ces mœurs rustiques, ces
ripailles, ces danses, ces amours champêtres (…).»
Bien entendu, nous ne pouvons plus vérifier les
sources de Van Mander, mais cette anecdote est pleine d’ambiguïtés.
Bruegel et Franckert se seraient travestis pour entrer dans la peau
de deux voyeurs afin de pouvoir traduire sur le papier et sur la
toile, avec réalisme, des scènes de la vie paysanne.
 Pieter Bruegel l'Ancien, «La Danse des paysans», huile sur bois, 119,4 x 157,5, vers 1568, «Kunsthistorisches Museum», Vienne.
Pieter Bruegel l'Ancien, «La Danse des paysans», huile sur bois, 119,4 x 157,5, vers 1568, «Kunsthistorisches Museum», Vienne.L’idée
n’est pas saugrenue puisqu’à cet égard également Karel van
Mander nous montre l’exemple, en évoquant la fascination que la
vie paysanne exerce sur Bruegel. Avec son ami Hans Franckert, raconte
Van Mander, le peintre assiste à des noces paysannes pour y trouver
l’inspiration: «À deux, Franckert et Bruegel prenaient plaisir à
aller aux kermesses et aux noces villageoises, déguisés en paysans,
offrant des cadeaux comme les autres convives et se disant de la
famille de l’un des conjoints. Le bonheur de Bruegel était
d’étudier ces mœurs rustiques, ces ripailles, ces danses, ces
amours champêtres (…).»
Bien entendu, nous ne pouvons plus vérifier les
sources de Van Mander, mais cette anecdote est pleine d’ambiguïtés.
Bruegel et Franckert se seraient travestis pour entrer dans la peau
de deux voyeurs afin de pouvoir traduire sur le papier et sur la
toile, avec réalisme, des scènes de la vie paysanne.
À ce récit apparemment irrésistible, Timmermans
attache en 1928 un amour du peuple qui vaut au peintre le surnom de
Boeren-Bruegel
(Bruegel le Paysan) et qui participera petit à petit à un processus
d’identité nationale au cours des décennies suivantes. Bruegel
devient «l’un des nôtres», autrement dit: il appartient aux
Flamands. Cela n’a rien d’étonnant. En effet, le mythe présente
tous les ingrédients nécessaires pour séduire les flamingants
lettrés. Il y a le rapport en réalité problématique avec le monde
rural: les gens qui travaillent la terre sont glorifiés pour leur
simplicité et leur honnêteté, mais toujours à distance. L’humour
aussi joue un rôle stratégique important grâce auquel Bruegel
devient un homme qui reste toujours prudent, qui, par son
déguisement, conserve une attitude ironique tout en étant capable
d’exprimer sincèrement l’amour qu’il éprouve pour le peuple.
On peut se demander si ce sentiment, la
glorification à distance du monde rural, n’était pas déjà
partagé à l’époque de Bruegel. Ses commanditaires étaient des
citadins. Ils n’appartenaient pas à la noblesse mais gagnaient
leur vie grâce à l’avènement du commerce. L’un d’eux était
l’Anversois Nicolaas Jonghelinck (1517-1570), dont on sait qu’en
plus d’une douzaine d’autres œuvres en sa possession, il avait
commandé La Moisson
au peintre en 1565. À l’époque, une moisson abondante était tout
sauf une évidence. En raison des conditions climatiques – décrites
aujourd’hui comme «le Petit Âge glaciaire» -, les hivers étaient
rudes au point que l’Escaut gelait, et les étés étaient humides.
À cette époque déjà, une ville comme Anvers était tributaire de
l’importation du seigle des régions baltiques pour nourrir ses
habitants. Lorsque l’Escaut gelait, la population était réduite à
la famine et des troubles éclataient. Ce que l’on voit est donc un
fantasme, un «pays de cocagne» comme l’explique si bien
l’historien néerlandais Herman Pleij dans l’un de ses livres
(Dromen van Cocagne. Middeleeuwse
fantasieën over het volmaakte leven –
Des rêves de cocagne. Fantaisies médiévales sur la vie parfaite,
1997).
J’enfonce une porte ouverte lorsque j’affirme que le mouvement flamand n’a jamais vraiment accepté la culture urbaine, si tant est qu’il ait jamais mené une vraie réflexion sur le sujet ou qu’il l’ait même compris.
 Pieter Bruegel l'Ancien, «La Chute des anges rebelles», huile sur bois, 117 x 162, 1562, musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles.
Pieter Bruegel l'Ancien, «La Chute des anges rebelles», huile sur bois, 117 x 162, 1562, musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles.Il n’est donc pas
étonnant qu’on ne se soit jamais demandé si la vie campagnarde et
le monde rural n’étaient pas déjà idéalisés au XVIe
siècle par des gens qui vivaient du commerce et dont certains
n’avaient aucun scrupule à spéculer sur le prix du blé en
période de famine.
Fini
le «Bruegel le Paysan»
Le
mythe de «Bruegel le Paysan» a la vie dure, comme toutes les
idylles. En Belgique même, le travail purement scientifique d’un
Manfred Sellink ou de représentants de la nouvelle génération de
chercheurs comme Tine Meganck n’en est que plus important. En
réalité, ils montrent que le champ est toujours ouvert et qu’il
reste énormément à découvrir. La splendide rétrospective qui a
eu lieu à Vienne (octobre 2018-janvier 2019) a selon moi
définitivement jeté aux oubliettes l’image de «Bruegel le
Paysan», grâce surtout à la recherche sur les matériaux. On a pu
y découvrir l’un des plus grands peintres de tous les temps qui,
surtout, demeure insaisissable et inclassable. Le piège serait de
considérer Pieter Bruegel presque comme un artiste autonome parce
que nous sommes désormais certains que chaque trait de pinceau est
de lui. Fait exceptionnel, même pour l’époque, il n’avait aucun
assistant. On pourrait donc être tenté de l’envisager entièrement
hors de son époque et des circonstances dans lesquelles il proposait
ses œuvres à la vente. Car que savons-nous vraiment du rapport
qu’il entretenait avec ses différents commanditaires, un rapport
dont nous admettons qu’il devait aussi comporter un échange d’un
riche contenu? Bien peu. Si nous nous penchons ensuite sur l’étude minutieuse menée sur La Chute des anges rebelles ou sur le milieu d’Abraham Ortelius, l’un des plus grands amis du peintre – deux études réalisées par Tine Meganck -, ce monde de Bruegel ne fait que s’enrichir de l’interaction que Meganck tente de révéler entre Bruegel et ses contemporains.
La clé de la magie
Bruegel nous pousse tous dans nos derniers retranchements. En effet, un peintre qui donne à un enfant de dix ans l’impression de l’avoir compris et qui redevient un mystère une fois l’enfant devenu adulte – alors que cet adulte continue de scruter son œuvre -, un tel peintre, donc, a tout pour nous désarçonner.
D’une certaine
façon, Bruegel nous a même appris à regarder. Il «dirige notre
regard», comme l’a un jour décrit Manfred Sellink, et on ne peut
qu’en faire le constat. Souvent, Bruegel nous révèle que des
choses spectaculaires, comme le chemin de croix du Christ ou Saül
qui tombe de son cheval après avoir eu une vision céleste, sont des
choses mineures vouées à l’indifférence, à la distance ou au
manque d’attention. Il peint tout autour une masse de personnages
qui sont pratiquement tous plongés dans leur monde intérieur. On ne
se lasse pas non plus de regarder un tableau comme Margot
la Folle, par exemple, et on se demande
si elle est elle-même présente mentalement dans le décor
apocalyptique dans lequel Bruegel la place. Je pense que c’est là
que se trouve la clé de la magie qu’il exerce sur nous. Il est à
la fois humainement reconnaissable et mystérieux par manipulation.
Ses œuvres semblent nous chuchoter à l’oreille que nous devons
continuer à regarder et à nous perdre dans nos réflexions. Il se
pourrait que Van Mander ait vu juste quand, en 1604, il décrivait le
maître comme un peintre déguisé qui se fond dans un paysage, un
joueur qui peint des énigmes que nous considérons au premier regard
comme captées sur le vif. Cela signifie d’ailleurs aussi que nous
pouvons regarder ce déguisement indéfiniment: une énigme, une
mascarade annoncée.