De Lille à Trieste
Boris Pahor a survécu à la grippe espagnole en 1918 ainsi qu’aux camps de concentration allemands en 1944-1945. Il a souffert dans sa chair sous les trois idéologies du XXe siècle (le fascisme, le nazisme et le communisme) et les a toutes trois combattues. Aujourd’hui, à la table de sa cuisine qui surplombe le golfe de Trieste, il appelle, aveugle mais lucide, à un Parlement européen et, d’ici un siècle, à un parlement mondial qui ne tolérera guère que qui ce soit meure de faim.
Qu’est-ce que Lille et Boris Pahor (Trieste, °1913), l’écrivain slovène de Trieste, ont en commun? Tout et rien. Le 15 avril 1945, Bergen-Belsen est libéré. Boris Pahor, affaibli et malade (il s’avèrera plus tard qu’il avait contracté la tuberculose) compte parmi les survivants du camp. Prisonnier politique. Triangle rouge. Il avait déjà derrière lui une odyssée dans les camps de Dachau, Dora et Natzweiler-Struthof en Alsace. Il a survécu, parce que sa connaissance des langues lui a permis de devenir interprète et infirmier.
 Le jeune Boris Pahor en tenue de camp de concentration
Le jeune Boris Pahor en tenue de camp de concentrationLe 1er mai, par le hasard des trains qui circulent là où les rails les mènent à travers une Europe encore en guerre, il descend en gare de Lille. Cette ville deviendra celle dans laquelle il devra s’habituer à nouveau à la vie et à la liberté, dans sa tenue de camp rayée, et avec quelques compagnons d’infortune. À la radio, il entend que les troupes de Tito ont envahi sa Trieste. Dans Libération, il lit que le cadavre mutilé de Mussolini a été suspendu par les pieds à un crochet sur une place à Milan. Dans le dortoir d’un ancien monastère, il a droit à un vrai lit, avec un vrai matelas et des draps frais. En ville, il se fait raser gratuitement par un coiffeur. Il évoque cet épisode dans une nouvelle intitulée «Le berceau du monde», dont voici le premier chapitre:
LE BERCEAU DU MONDE
À Anne Marie
Lille. Une ville dont je connais quatre rues et un bâtiment. Gris, imposant, carré, probablement un ancien monastère qui a été transformé en caserne. Mais il existe nombre de villes dont on sait encore moins de choses… Salle d’attente de troisième classe, sac à dos militaire sous la tête, mégots et assoupissement dans l’attente du tohu-bohu du train de nuit… L’ensemble peut néanmoins être regroupé sous un seul nom : Lille. Après cette expérience, on peut imaginer les yeux étonnés des Grecs quand ils aperçurent la mer après avoir échappé au désert. Thalassa. Thalassa. Peut-être est-ce en vain que nous essayons de sentir le battement désordonné de leurs cœurs ; pour eux en effet, le silence tendu, dense, était sans doute le discours le plus éloquent.
C’est le matin. Un matin de mai. Le train avance lentement, il glisse presque le long du quai. Dans le silence. Comme s’il rampait vers un piège mystérieux. Même si le silence, inhabituel pour nous, ne tient qu’à l’absence de vociférations, ce calme étrange éveille chez les revenants une inquiétude qui confine à la panique. Pourtant à ce moment-là, on n’en a pas conscience, on ne se rend pas compte qu’au pays de la mort, tout l’humain était réduit à un cri sauvage, agressif, alors que, au-delà de la frontière fatale, la valeur de l’existence se concentre dans un silence riche et plein. Seules, les rayures bleuâtres de nos vêtements témoignent encore de l’au-delà. Des corps descendent du train, d’autres sont sur des brancards, leurs rayures bleues et grises, telles des flèches tranchantes, déchirent l’atmosphère en tous sens, marques visibles des vociférations, tracées sur le prisonnier pour l’empêcher de se dérober insensiblement à la mort.
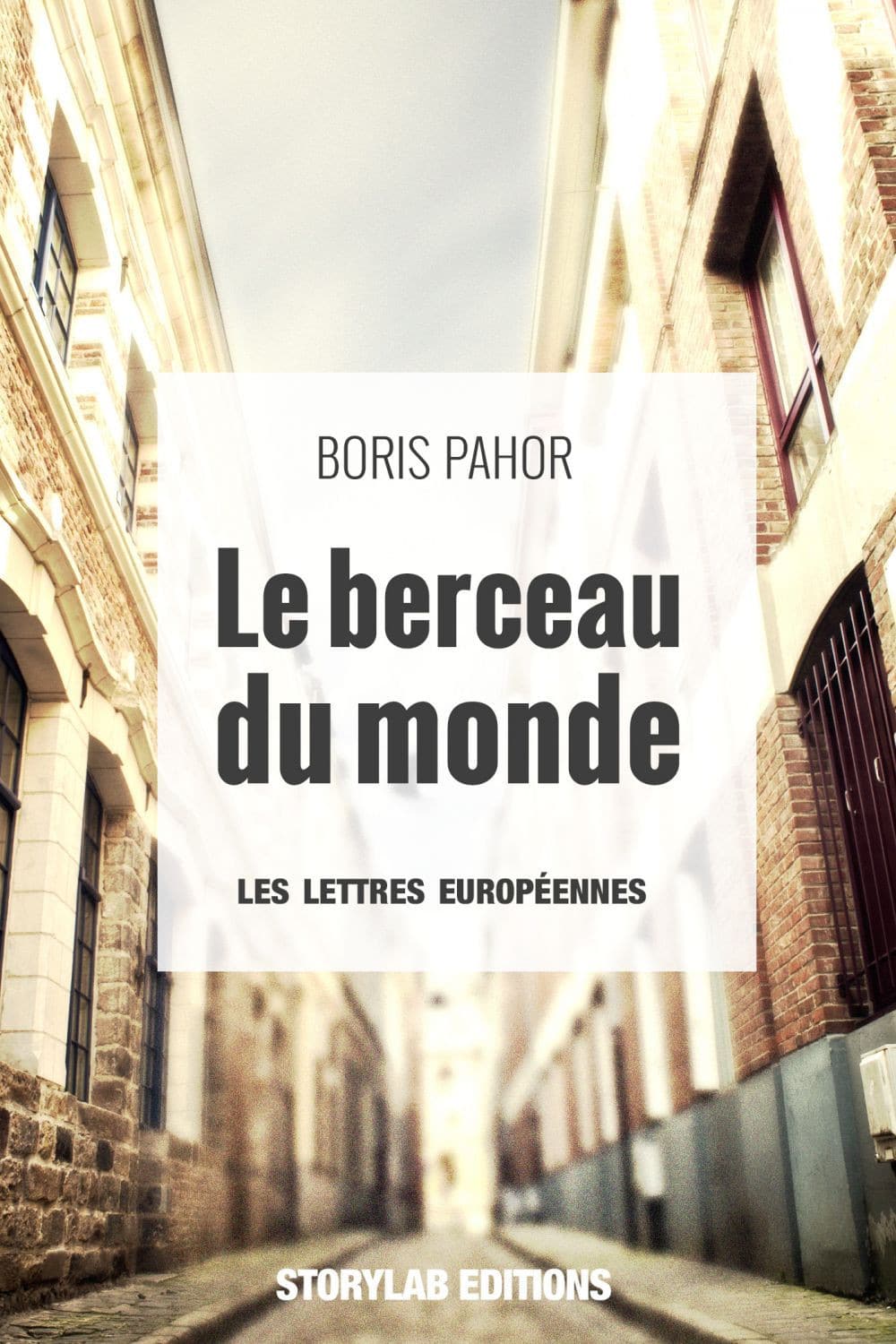
Il n’y a jamais de représentation du Crucifié sans une femme qui protège son corps et reste à ses côtés, le cœur et les yeux remplis de bonté et d’impuissance. Là-bas, sur le quai, les femmes étaient désappointées, elles avaient en vain cherché parmi nous les traits familiers pour lesquels elles avaient amassé une ineffable provision de compassion. Elles s’approchaient d’un visage amaigri, commençaient par suivre un trait connu du côté des yeux, se troublaient puis vite, se rendant compte de leur erreur, passaient au suivant. Alors elles se penchaient sur ceux qu’on avait laissés sur les marches du wagon ou bien sur les civières. Leurs yeux essayaient de percer le mystère du néant à travers le grillage des rayures. Puis elles quémandaient des nouvelles, citaient des dates et des chiffres, et la rencontre avec ces visages féminins avait un air de folie naïve. Sentiment maternel de la femelle qui cherche, aveugle et fébrile, dans la masse zébrée et qui n’a pas le temps de penser que les chiffres habituels n’ont pas de sens dans le monde hors norme sur lequel elle pose des questions. Cependant, comme si le contact avec le sol natal avait fait de nous de bons et serviables voyageurs, certains, avec conviction, annoncent aux femmes l’arrivée de nouveaux transports, ils leur donnent de l’espoir. Mais on dirait que c’est moins par affection filiale qu’ils agissent ainsi qu’en raison d’une tension communicative presque exubérante et de l’impatience qui résulte de la conscience d’être réellement sauvé. Et les femmes ont l’air de s’en rendre compte car elles n’écoutent pas, elles suivent machinalement du regard les traits des pommettes qui leur semblent connues. Elles s’arrêtent aux commissures des lèvres, elles sautent au front. Sur le crâne rasé. Reviennent à la bouche. Quand enfin elles tournent la tête pour chercher un nouveau visage, la gare silencieuse éclate du vide désorienté de leurs yeux.
Ensuite le bâtiment gris. Une gigantesque boîte. Passer des baraques minuscules, de ces cabanes pourries, à ces vieux murs épais, c’est revenir dans l’histoire sage, réelle, encadrée. On a l’impression que ces murs solides sont là délibérément, pour protéger ce qui reste de notre fragile et vulnérable humanité. Même si les naufragés qui sont assis derrière les longues tables où se trouvaient autrefois des hommes en soutane priant l’Être parfait au-delà du monde sensible n’ont qu’une faible foi dans l’homme, il plane dans l’air la possibilité au moins pressentie d’une nouvelle réconciliation. D’autant plus que dominent dans la pièce les uniformes bruns des militaires français qui permettent aux tenues rayées de dissimuler facilement leur misère fripée. Oui, de longues tables. Une série de portes vitrées de l’autre côté de la cloison à gauche, et nous, les nombreux pensionnaires d’une maison de redressement, qu’on rendra peut-être capables de renouer des contacts normaux avec les gens. Et signe que nous sommes tous égaux devant l’avenir, chacun a près de lui une boîte en carton, cadeau de la Croix-Rouge américaine. On la tient à côté de soi, sur la table. Par terre, près de ses chaussures. Sous le bras.
Ces paquets, à cause de la croix carmin, ressemblent à des trousses de premier secours ; on dirait que tout le monde a reçu du liquide désinfectant et des pansements pour des blessures qu’il faudra traiter avec patience et sollicitude.
Les lits sont nombreux, les dortoirs longs. Larges aussi. Mais il y en a de tout petits, à deux, trois lits. Ces lits en fer sont garnis de vrais matelas, si épais qu’ils ont l’air un tout petit peu moins grands que les lits habituels ; ce sont de vrais lits, directement issus de notre mémoire, avec un drap de dessus replié vers l’extérieur, et même rentré en un étroit et long triangle le long du bord. Et c’est à vrai dire grâce à cette toile immaculée qui lui offre un accueil franc, doux et engageant que le corps comprend en un éclair qu’il est sauvé. Cette impression d’accueil, d’abord froid, mais qui se réchauffe par la suite rappelle aux sens la proximité d’un corps inexpérimenté de jeune fille dans lequel de petites étincelles naissent aisément grâce à de douces caresses.
François et René veulent aller en ville.
«Bien sûr, ta toux», dit René. «Mais maintenant tu vas avoir du temps à revendre et tu pourras être tranquillement malade !»
(Traduit du slovène par Andrée Lück-Gaye)
Boris Pahor est né en Autriche, dans l’empire des Habsbourg, et plus précisément à Trieste, la seule grande ville portuaire que la monarchie d’Autriche possédait sur la mer Méditerranée. Il appartient à la minorité slovène qui vit dans la ville et ses environs depuis un millier d’années. La Trieste d’avant-guerre est un creuset florissant, mercantile et cosmopolite de langues et de cultures, un lieu où l’Europe centrale (Vienne!) rejoint l’azur de la mer Méditerranée, c’est la ville d’Italo Svevo (pseudonyme d’Aronne Hector -Ettore- Schmitz, un juif germano-italien), du poète Umberto Saba et de James Joyce. En ville, l’élite parle allemand, la bourgeoisie, italien et les villageois en dehors, slovène.
Boris Pahor se souvient toujours du bruit de la guerre: «Il retentit dans les murs. Le grondement, le bruit sourd des canons sur le front». En 1918, une épidémie s’est propagée à Trieste, qui fera plus de victimes en Europe et dans le monde que la guerre elle-même: la grippe espagnole.
 Statue de Boris Pahor à Ljubljana
Statue de Boris Pahor à LjubljanaEn mars 2020, également en quarantaine dans sa maison surplombant le golfe à Trieste et à presque 107 ans, il a déclaré, à ce sujet, ce qui suit:
«Trieste faisait alors encore partie de l’empire austro-hongrois. Avant la guerre, mon père vendait du beurre, du miel et du fromage blanc sur le marché de Ponterosso, avec son étal roulant exposé à tous les vents. Les jours de bora, il se protégeait avec un journal qu’il glissait sous sa veste. Mais au moment de l’épidémie, il n’était pas à la maison, mobilisé dans l’armée autrichienne, comme photographe de guerre. Je n’étais alors âgé que de cinq ans et cette épidémie fut un désastre car nous étions seuls, ma mère, mes deux jeunes sœurs et moi. Mimitza avait trois ans, Evelyna deux ans. Tous atteints, avec quarante de fièvre, transpirant de sueur. Impossible de quitter le lit, d’être secourus. Nous vivions alors au 28, Via Commerciale dans une sorte de cave. Une pièce unique en sous-sol où mon père avait tendu un fil de fer. Maman y avait accroché une toile en guise de séparation, d’un côté la chambre, de l’autre la cuisine. Je me rappelle qu’il y avait dehors un peu d’herbe, quelques arbres, je jouais là avec ma jeune sœur, Mimitza. Elle était toute petite. Mimitza est un diminutif, cela veut dire Marie.
Mon grand-père paternel, ne pouvait nous venir en aide. Avec ma grand-mère et mon cousin Cyril, qui devait se suicider quelques années plus tard, il habitait dans une mansarde sous les toits, près du canal Grande, cette langue de mer qui pénètre au cœur de la vieille ville, là où mouillent les vieux bateaux à fond plat. Ils attendent le printemps pour sortir, quand la marée basse laisse un passage assez large sous le Ponterosso. Tout près, sur ce marché du Ponterosso, des femmes slovènes descendaient du plateau karstique pour vendre les produits de leur ferme. C’est l’une d’elles qui est venue nous porter secours. Qui l’a alertée, je ne sais pas, mon grand-père sans doute car il ne pouvait se déplacer. Je me rappelle qu’elle nous a préparé du thé. Je m’en souviens bien car nous mourions tous de soif à cause de la fièvre. Finalement nous avons guéri. Sauf ma petite sœur, Mimitza. Elle était délicate, comme le sont aujourd’hui ceux qui décèdent du Covid-19, les personnes âgées, les malades. Elle n’a pas survécu mais aujourd’hui, je pense qu’on l’aurait sauvée. Je me rappelle la douleur de mon père, je me rappelle que tous les jours il fleurissait sa tombe.

Et pour nous pas de répit. Peu de temps après, ce fut une autre catastrophe, l’incendie de la Maison slovène de la Culture provoqué par les chemises noires et le début du fascisme avec l’interdiction de parler notre langue, l’obligation d’italianiser nos patronymes, «les Slovènes, des poux à écraser !», écrira le frère de Mussolini dans le journal Il Popolo d’Italia.
C’était en 1920, il y a cent ans de cela. Une autre contamination, une peste brune commençait à envahir l’Europe. Et combien y en eut-il ensuite, des milliers et des millions de poux que l’on s’est acharné à écraser ?
Je veux espérer que le mal d’aujourd’hui sera différent d’alors, que l’épidémie se trouvera rapidement enrayée. Les peuples n’ont-ils pas assez souffert ? Je souhaite de tout coeur que toutes ces souffrances en viennent un jour à nous enseigner la sagesse…»
(Propos recueillis par Anne-Marie Mansuy)












