Journée mondiale de la langue maternelle : le frison
En 1999, le 21 février a été déclaré Journée internationale de la langue maternelle par l’UNESCO. Cette date a été choisie en hommage aux étudiants tués par la police à Dacca (la capitale du Bangladesh actuel) en 1952, alors qu’ils manifestaient pour la reconnaissance de leur langue maternelle, le bengali, comme langue officielle de l’ancien Pakistan oriental. De nos jours, cette journée a pour but de promouvoir la diversité linguistique et culturelle et de rappeler l’importance du multilinguisme et de l’accès pour tous à un enseignement de qualité dans sa langue maternelle.
La langue maternelle est également le fil conducteur du livre Debout dans Babel, dans lequel 16 auteurs expliquent, au travers d’essais, leur relation avec leur langue maternelle et les autres langues qui font partie de leur univers personnel. Aujourd’hui, nous avons décidé de mettre à l’honneur le frison, à travers le témoignage d’Albertina Soepboer. Le frison, qui a le statut de langue officielle aux Pays-Bas depuis 1970, est enseigné dans la plupart des établissements en Frise. Il a également été reconnu par l’Union européenne comme langue minoritaire en 1992. Albertina Soepboer (° 1969) écrivaine d’origine frisonne, raconte sa découverte du bilinguisme, aborde le sujet du statut minoritaire du frison et partage sa passion pour la littérature frisonne et néerlandaise.
 Albertina Soepboer.
Albertina Soepboer.© T. Soepboer.
Ma première langue… le frison
Ma première langue, ma langue maternelle, la langue que ma mère m’a parlée dès le berceau, c’est le frison. Je suis venue au monde à l’extrême nord des Pays-Bas, dans la province de Frise, et j’ai été élevée à Holwerd, un petit village au bord du Waddenzee. À la maison, nous parlions frison, et c’est dans cette langue que mon univers a pris forme lorsque j’étais enfant. Les sièges, le chat, les jouets, les plantes devant la fenêtre ont reçu leur premier nom en frison. Un beau jour, le monde est devenu plus grand que la maison. Il y a d’abord eu la rue, puis les prés, et enfin le Waddenzee. Tout comme les choses de l’intérieur, celles du dehors ont été nommées en frison. Un de mes grands-pères m’a dit que les baies roses et sucrées dont je raffolais s’appelaient framboazen. Mon autre grand-père m’a enseigné ce mot spécial désignant un petit cheval: happe. Ma mère m’a appris que le petit objet jaune pondu par la poule s’appelait aai.
 Cheval frison
Cheval frisonPar mon père, j’ai su que le veau marin dont je voyais dépasser la tête brune tandis qu’il nageait dans le Waddenzee portait le nom de seehûn. Ainsi, chaque nouvelle découverte s’accompagnait d’un nouveau mot de vocabulaire. C’était un monde sans problème. Les mots et les choses allaient ensemble. Mais les mots avaient quelque chose d’amusant. J’ai vite compris que l’on pouvait répéter les mots à l’infini et en faire des chansons. Puis, le mot ne collait plus à la chose, il allait mener sa vie propre. Certains mots allaient ensemble, d’autres pas. Et c’est tout cela que, devenue écrivain, je fais encore toujours de mon frison: j’en joue jusqu’au moment où je trouve ce que je veux coucher sur le papier. Mais le monde était plus vaste.
Il n’a pas fallu longtemps pour que ce beaucoup plus vaste monde s’introduise dans celui qui abritait mon frison. Sans doute, un jour, quelqu’un aura-t-il allumé la radio ou la télévision. J’ai entendu un langage dont, au premier abord, je ne dois pas avoir compris grand-chose. Mais cela doit avoir changé assez vite, car cette langue résonnait du matin au soir, comme si un émetteur envahissait mon petit monde de toutes parts.

© M. van Kammen
Quelqu’un, alors, a dû me dire que cet émetteur diffusait du néerlandais et que c’était une langue. Et voilà qu’un nouveau mot était entré dans le monde de ma langue, un mot dont je ne pouvais savoir à ce moment qu’il débouchait sur un nouvel univers linguistique. Un mot qui allait ouvrir les portes du monde de la même manière que l’avait fait pour moi le frison.
… et ma deuxième
Un autre jour encore, j’ai pris le chemin de l’école. Au tableau noir, une illustration montrait une rose avec, au verso, le mot roos. Madame nous a appris à lire ce mot, puis à l’écrire, lettre par lettre. Cela se faisait en néerlandais, la langue de la radio et de la télévision. En classe, désormais, on lirait et on écrirait roos, alors que la plante dans le jardin se disait roas. Deux mondes linguistiques différents étaient nés. Parfois, ils se rejoignaient, comme lors des rares leçons de frison où les deux langues se côtoyaient en classe primaire. Ou quand les élèves étaient réunis devant la TV pour commenter une émission. Les années d’école primaire ont suscité chez moi quelque chose de crucial pour un écrivain: la soif de lecture. Mes parents m’avaient appris à lire le frison et nous avions à la maison une étagère de livres pour enfants écrits dans cette langue. Cela m’a permis d’apprendre à lire correctement dans ma première langue. Vint le moment où j’avais tout lu. Heureusement, les deux petites bibliothèques du village possédaient une mine de livres en néerlandais.
 Drapeau frison
Drapeau frison© Friesland Holland
C’est ainsi que, toute jeune, j’ai fait une ample moisson de récits qui se sont profondément ancrés en moi et ont constitué la base de beaucoup de choses que j’écrirais par la suite. J’étais friande de contes de fées, de contes fantastiques et de contes populaires, et je continue à m’en inspirer souvent dans mes poèmes et dans mes récits. L’entrée en secondaire voulait dire quitter une école de village pour fréquenter un établissement situé dans une petite ville de province.
De nouveaux mondes linguistiques se sont alors ajoutés: l’anglais, l’allemand, le français, le latin et le grec. Au cours de néerlandais, il était beaucoup question de littérature, mais les autres langues ont également pris vie par le biais de la littérature. Troublée par L’Étranger d’Albert Camus et obligée de me débattre avec la langue française, je me suis retrouvée, des journées entières, spectatrice intriguée de choses que, jusqu’alors, j’avais toujours considérées comme allant de soi. Le monde mythique d’Homère, décortiqué en classe mot par mot dans l’original, n’allait plus me quitter, et la mystérieuse poésie d’Emily Dickinson me révélait la subtilité et les ambiguïtés de l’anglais.
 Holwerd.
Holwerd.© Het Friesch Dagblad
Tout naturellement, les premiers poèmes et récits que j’ai écrits étaient en néerlandais, la langue que nous pratiquions couramment en classe et celle de la littérature que nous avions tous les jours sous les yeux. C’est par cette langue que j’ai découvert des notions telles que le style, l’analyse et l’intrigue d’un récit. C’était la langue dans laquelle je pensais et m’exprimais. Elle est devenue un outil qui permettait de donner forme au monde de toutes sortes de manières.
Très vite, j’ai rejoint la rédaction du journal de l’école, où ma passion pour l’écriture trouvait un exutoire. Ma première langue, le frison, n’était pas utilisée en classe. Il était en principe interdit aux enseignants et aux élèves de s’en servir en milieu scolaire. Un petit nombre d’élèves et de professeurs ne la maîtrisaient pas. Mais, inévitablement, la barrière linguistique était franchie de temps à autre. Un professeur d’histoire enseignait l’histoire de Frise en frison, en quoi il faisait figure de révolutionnaire dans cet établissement. En fin de journée, il était loisible de suivre un cours de frison, option passablement subversive de la part d’élèves qui avaient déjà si peu de temps.

Pour le reste, le frison n’avait sa place qu’aux intercours, à la récréation ou dans les blagues. La situation linguistique n’était pas abordée ouvertement, mais chacun en avait connaissance. À l’époque, j’ai publié dans le journal de l’école deux poèmes en frison, qui m’avaient coûté beaucoup d’efforts. Ils ont été accueillis par un silence de mort. Le message était clair: une telle combinaison ne pouvait exister. La littérature en frison ne pouvait constituer une matière d’étude. Si bien que, lorsque je suis sortie du secondaire, le cartable plein de langues, la seule qui manquait était la première, la langue maternelle.
Mon bilinguisme
Le passage du secondaire à l’université revenait à quitter un milieu majoritairement frison pour rallier la cité estudiantine de Groningue, où on ne parlait que néerlandais. Le nouvel environnement et les études requéraient toute notre application. Dans ce nouveau cadre de vie, il semblait que je dusse dire adieu au frison et à mes timides débuts d’écrivain. En fait, c’est justement cette transition qui a permis de donner un nom à mon statut linguistique personnel et qui a fait que j’ai pu me mettre sérieusement à l’écriture.
Étudiant les langues et les cultures romanes, j’ai été confrontée à la notion de bilinguisme, phénomène que connaissent tous les pays romans. Cela a débouché sur des concepts et statistiques en rapport avec le bilinguisme.
J’avais l’impression de me réinventer moi-même, y compris comme écrivain. J’ai continué à écrire en néerlandais, mais je me suis également mise prudemment au frison, que je maîtrisais à peine. Au bout de deux ans, je me suis inscrite à des cours de frison à l’université. J’ai enfin appris à bien l’écrire et, plus important encore, j’ai appris qu’il existait une littérature en frison en dehors des livres pour enfants que j’avais lus.
 Waddenzee
Waddenzee© Hollandse Hoogte / F. Lemmens
Dans la foulée de cette étude, j’ai créé avec quelques condisciples un cercle d’écrivains. Je n’ai pas tardé à publier mes premiers poèmes en frison et en néerlandais. J’ai cru un moment que j’avais enfin trouvé un chez-moi. Comme étudiante, ce n’était pas un problème d’apprendre simultanément l’espagnol, l’italien, le français et le portugais. Comme écrivain, je m’adonnais en même temps à la littérature frisonne et à la littérature néerlandaise.
La chance que j’avais de devenir polyglotte à la fois par mes études et en tant qu’écrivain m’apparaissait comme un formidable enrichissement. Et cet état me semblait tout naturel lorsqu’on est possédé par l’amour de la langue. C’était une erreur, ainsi que je m’en suis rendu compte quelques années plus tard, alors que je venais de publier mon premier recueil. Une erreur funeste, même. Chaque fois que, comme écrivain, je franchissais la frontière, soit vers Leeuwarden, chef-lieu de la province de Frise, soit vers Amsterdam, capitale des Pays-Bas, j’étais brutalement ramenée à la dure réalité. En Frise, j’ai appris qu’il n’y avait pratiquement pas de place pour la notion de bilinguisme dans la littérature frisonne.
 Leeuwarden
LeeuwardenLa sentence tenait en quelques lignes qui m’ont obsédée des années durant: elle disait que, comme écrivain, j’avais affaire à une langue minoritaire et, précisément en tant qu’écrivain, pour qui la langue avait tellement d’importance, j’étais tenue d’assurer la sauvegarde de cette langue. Que le frison était ma première langue et que dès lors, en ma qualité d’écrivain, c’est dans cette langue que je me devais d’écrire. Que je pourrais ainsi mieux exprimer mes sentiments. Qu’il valait mieux pour la Frise et la littérature frisonne que j’écrive en frison. J’avais l’impression de trouver sur mon chemin une sorte d’acte de foi, pas une langue ou une littérature. Langue minoritaire. Ma première langue était une langue minoritaire. Il s’ensuivait, par une déduction étrangement automatique, que ma deuxième langue était une langue majoritaire. C’est d’ailleurs ainsi que cela fonctionnait concrètement. Même si, dans bien des cas, les gens savent que je suis un écrivain bilingue, ils disent: c’est un auteur qui écrit aussi en frison. Ce sont deux mondes différents qui cohabitent aux Pays-Bas, mais qui se fréquentent à peine, et nulle part, apparemment, une passerelle n’a été jetée entre eux. Pour un écrivain placé dès ses débuts devant pareille situation, il n’y a qu’une réponse possible: continuer à écrire. C’est ce que j’ai fait pendant dix ans.
Ma réalité en tant qu’écrivain
Aux Pays-Bas, les gens du Nord ont la réputation d’être têtus. De fait, je me suis obstinée à continuer d’habiter Groningue, cette ville quelque part entre Leeuwarden et Amsterdam, cette ville du Nord, cette ville aussi où d’autres jeunes écrivains frisons sont allés travailler dans deux langues. On y respirait un air de nouveauté. Une réalité bilingue dans laquelle, parfois, il m’est arrivé de me sentir chez moi. C’est là également que je me suis construit ma réalité personnelle d’écrivain: lorsque, le matin, il pleut et que je sors les poubelles, l’arbre derrière ma maison est légèrement humide.
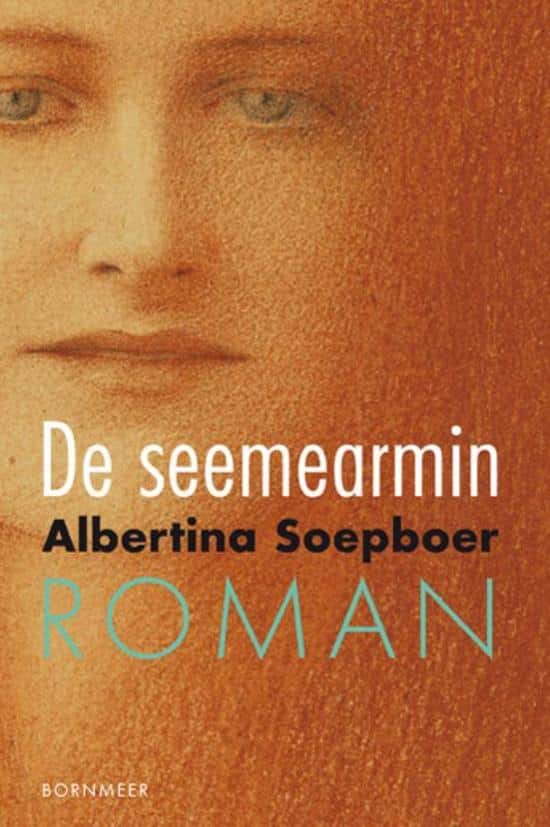 Albertina Soepboer, «De seemearmin», 2012
Albertina Soepboer, «De seemearmin», 2012Aux Pays-Bas, les gens du Nord ont la réputation d’être têtus. De fait, je me suis obstinée à continuer d’habiter Groningue, cette ville quelque part entre Leeuwarden et Amsterdam, cette ville du Nord, cette ville aussi où d’autres jeunes écrivains frisons sont allés travailler dans deux langues. On y respirait un air de nouveauté. Une réalité bilingue dans laquelle, parfois, il m’est arrivé de me sentir chez moi. C’est là également que je me suis construit ma réalité personnelle d’écrivain: lorsque, le matin, il pleut et que je sors les poubelles, l’arbre derrière ma maison est légèrement humide. Je marmonne quelque chose à propos d’un bouleau à moitié vert et d’un printemps qui va venir. Et, tout en marmonnant, j’entre dans mon bureau près de l’arbre du jardin.
Je vais dans ce jardin, mon café à la main, et je m’adresse à mon bouleau en l’appelant bjirk. Et il se fait qu’il se nomme aussi berk. Une sorte de magie opère alors, les deux langues s’effleurent, des mots et des images surgissent, je m’assieds quelque part et, l’instant d’après, je sais dans quelle langue l’écriture doit venir et je m’installe devant mon PC. Quand le texte est prêt, j’ai le choix de l’envoyer à mon éditeur frison à Leeuwarden ou à mon éditeur néerlandais à Amsterdam. Parfois, j’abandonne là les deux bouleaux, je fais mes valises et je pars pour un de ces nombreux pays où l’on parle une langue romane, je vais goûter à une de ces langues.
Et c’est là que j’écris, avec cette langue-là comme douce musique de fond. La seule chose que je fais en maniant la langue, c’est créer un monde dans lequel chaque langue puisse remplir sa fonction propre. Après dix ans, il s’est avéré que cela engendrait un terreau fertile où se produisaient de miraculeuses pollinisations croisées. La connaissance de plusieurs langues et de plusieurs littératures a singulièrement élargi mon horizon d’écrivain. Voilà, précisément, la réalité dans laquelle j’aime à me trouver: une réalité où les frontières sont tombées.







