«Le sentiment d’être de plain-pied dans un film français»: la gare du Nord déborde de l’amour des écrivains néerlandais et flamands pour Paris
Dans son livre Passage Parijs, le journaliste Dirk Leyman fait revivre les lieux littéraires de la Ville lumière, éternellement séduisante. En trente chapitres –consacrés chacun à un écrivain, un thème ou un lieu emblématique–, il guide le lecteur à travers le Paris des écrivains, philosophes et auteurs cultes français et internationaux, de Perec à Houellebecq et de Collette à Baldwin. Pour de nombreux écrivains, l’amour qu’ils expriment pour Paris commence par un coup de foudre à la gare du Nord. Dans ce chapitre présenté ici en traduction française inédite, l’auteur franchit la porte d’entrée de la Ville lumière dans le sillage d’auteurs néerlandais et flamands.
«Nos artistes doivent trouver la poésie des gares, comme leurs pères ont trouvé celle des forêts et des fleuves», plaidait à pleins poumons le naturaliste Émile Zola. «Peut-être le bonheur n’est-il que dans les gares!», ajoutait Charles Cros dans son poème «Tableau». Vers le milieu du XIXe siècle, les écrivains s’essayaient, non sans trémolos dans leur plume, à appréhender les nouveaux colosses de fer et de pierre. Les gares étaient le couronnement de la révolution industrielle, le cœur battant de toute métropole qui se respectait ou encore, selon Théophile Gautier, les «cathédrales de l’humanité nouvelle». Les locomotives à vapeur aux gueules écumantes qui s’apaisaient sous de mégalomanes toitures et coupoles frappaient l’imagination des prolétaires tout autant que celle des petits bourgeois, des littérateurs et des peintres. Des impressionnistes tels que Gustave Caillebotte, Édouard Manet et surtout Claude Monet ont immortalisé grouillement de gens et panaches de vapeur autour de la gare Saint-Lazare et du pont de l’Europe. Quant au poète Léon-Paul Fargue, il se figurait les gares voisines, celle du Nord et celle de l’Est, comme deux «vastes music-halls où l’on est à la fois acteur et spectateur».
 La gare Saint-Lazar peinte par Claude Monet, 1877
La gare Saint-Lazar peinte par Claude Monet, 1877© National Gallery
Pour sa part, dans Door gevaarlijke gekken omringd (Entouré de fous dangereux, 1988), Willem Frederik Hermans (1921-1995) écrit que la gare d’une métropole est comme «l’antre du dragon, lui correspondant par l’apparence et la taille, tout en ressemblant toujours de manière trompeuse à autre chose: un château, une église, un temple aux sinistres et pléthoriques ornements». Les gares aiguisent les sens, précise le romancier et polémiste néerlandais, car, une fois dans un tel lieu, «les personnes sensibles deviennent soit optimistes, soit malheureuses quand elles ne prennent pas peur, toutes sortes d’attentes envahissant leur imaginaire pour le reste vide». Et de conclure, morose, que «les gares ferroviaires» sont les «sex-shops du lointain».
La néoclassique gare du Nord ne fait pas exception à cette paraphrase. Construite entre 1861 et 1865 par l’architecte franco-allemand Jacques Ignace Hittorff, elle était clairement destinée à impressionner les gens qui venaient à passer. Les statues massives qui ornent sa longue façade en témoignent encore. Ce qui a subtilement inspiré à l’écrivaine française Malika Wagner ces lignes du roman Terminus Nord (1992): «On se trouvait dans la plus belle gare du monde. Dans la ville, la seule, la vraie. La gare du Nord où de voluptueuses femmes sculptées attendaient les voyageurs. Montant le guet sur le toit. Neuf en tout, leurs noms gravés sur la façade. On avait Amsterdam, Berlin, Cologne, Paris juste au milieu ainsi que d’autres villes grises et prospères dans leurs draperies de pierre depuis bien longtemps avant nous.» (1) De son côté, pour composer son livre Paris Gare du Nord (2011), Joy Sorman s’est installée pendant une semaine dans la gare, observant tout et s’immergeant dans la foule. Elle a agencé gens et événements en une sorte de chaîne de hasards.

© Dirk Leyman
Pour les écrivains et artistes belges et néerlandais, la gare du Nord a toujours été la porte d’entrée de Paris, ainsi que le narre en détail l’historien de l’art flamand Eric Min (°1959) dans son ouvrage éponyme datant de 2021. Il s’agit de l’une des grandes «gares terminus» de la capitale française, au même titre que la gare Saint-Lazare, la gare de l’Est, la gare de Lyon, la gare Montparnasse ou encore la gare d’Austerlitz. Ces dernières décennies, à plusieurs reprises, la gare du Nord s’est sentie à l’étroit. Depuis les années mille neuf cent quatre-vingt, elle s’est agrandie de façon labyrinthique, surtout en sous-sol, tout en étant rénovée et rationalisée afin de devenir le terrain de jeu des TGV dont, aujourd’hui en particulier, les Eurostars, ceci même s’il est toujours possible d’y prendre des lignes régionales en direction du Septentrion. Accueillant 292 millions de voyageurs par an, elle est souvent bondée. La multitude de portiques d’accès fait parfois de la traversée des lieux un véritable parcours du combattant.
Pour de nombreux auteurs d’expression néerlandaise, cette gare symbolise une entrée pour ainsi dire glorieuse dans la Ville lumière, une ouverture libératrice, la personnification d’un désir effréné et téméraire. Le crissement des freins du train annonce un paradis français qui va se déployer à l’aveugle. Philip Freriks (°1944), ancien présentateur du journal télévisé de la chaîne publique des Pays-Bas, et, dans sa jeunesse, contrôleur dans les trains de nuit des Wagons-Lits, évoque cela dans une veine amusante (Gare du Nord, 2004). «Sur le trottoir de la rue de Dunkerque commence l’autre monde, note-t-il. Esbroufant, irrésistible.»
Dans le roman Een zachte vernieling (Une douce destruction, 1988) de Hugo Claus (1929-2008), André Maertens, le personnage central, arrive à Paris à la manière d’un «Alexandre le Conquérant». En quelques coups de pinceau judicieux, l’auteur belge souligne l’exotisme de la métropole: «Dans la vapeur de la gare. S’agit-il là d’autochtones? Plus élancés, plus impétueux et à la peau moins claire que les Belges. […] Un vieil homme en salopette bleue trimballe un petit chat siamois dans une cage à oiseaux. Des Arabes coiffés d’un béret. Un Oriental tatoué tire une charrette chargée de tessons de porcelaine.» Une fièvre inexplicable s’empare du narrateur: «Un cœur battant à tout rompre. Je croyais que cela n’existait que dans les romans. Ça a commencé quand, penché par la fenêtre trépidante, des poussières de charbon me fouettant le visage, j’ai découvert la coupole blanche sur la colline entre les toits gris, Montmartre, mon minaret, ma Mecque.»
L’ironie n’est pas très loin, mais peut-être que l’émotion de base est comparable à ce dont se remémore le publiciste frison Alexandre Cohen (1864-1961) à propos du 12 mai 1888: «Paris! La France! Cela chantait et jubilait en moi: la France! Paris! J’aurais voulu embrasser le sol, et peut-être l’aurais-je fait si la gare du Nord n’avait pas été aussi moche.» L’anarchiste en herbe se montre surpris par les proportions encore modestes des bâtiments de l’époque: «Parmi les grandes gares parisiennes, aucune ne se prête aussi peu à une manifestation de cette nature, et aucune ne donne au voyageur, lorsqu’il en sort, une impression aussi désagréable de la ville des villes. Mais rien n’aurait pu me décevoir. N’étais-je pas à Paris?»
Pour Remco Campert (1929-2022), comme pour bien d’autres, cette gare terminus a été un tapis rouge donnant accès à l’attirante Ville lumière. En ce qui le concerne, c’était dans les années cinquante du XXe siècle: «Dès que je sors de la gare du Nord, j’ai envie d’écrire. J’en ai les larmes aux yeux. J’ai l’impression d’accéder à mon bureau, un bureau qui n’a pratiquement pas changé depuis les années cinquante. Déambulant dans Paris, j’écris à chaque instant. Pas ici, à Amsterdam où il m’arrive souvent de me dire: “Bon sang, mais qu’est-ce que je fabrique ici? Dans cette bourgade provinciale!”» (interview accordée à Jan Brokken). En ce qui le concerne, le dessinateur de presse Opland (1928-2001) associe la gare, où il débarque lui aussi depuis les Pays-Bas, à un autre monde, un monde majestueux: «Je me souviens de la gare du Nord, vaste, nue, sombre, de l’odeur des locomotives à vapeur et de ces immenses affiches de Dubonnet: Dubo, Dubon, Dubonnet. Une ville magistrale, c’était le grand monde.»

L’essayiste néerlandais Rudy Kousbroek (1929-2010), qui a vécu à Paris de 1950 à 1971, décrit son arrivée essentiellement comme une révélation intellectuelle: «En 1950, quand je suis descendu du train à la gare du Nord, je me suis retrouvé, sans avoir rien fait de particulier pour cela, dans un pays dont la langue et la littérature ne m’étaient pas inaccessibles. […] Je revois la ville telle que je l’ai alors vue: les larges rues sous la lumière matinale, l’eau argentée qui coule dans les caniveaux, l’architecture monumentale qui donne parfois l’impression irréelle d’un décor de cinéma. Le sentiment d’être de plain-pied dans un film français. Ce fut la plus grande aventure intellectuelle de ma vie et le sentiment de libération que j’ai éprouvé perdure encore aujourd’hui.» (La France aux Pays-Bas. Invloeden in het verleden, 1985). Pareille exultation ne pouvait toutefois convaincre son compatriote Joost Zwagerman (1963-2015): « Le lecteur d’aujourd’hui a l’impression que Kousbroek, en jetant ce coup d’œil rétrospectif, frise la sentimentalité alors qu’il se toque d’un Paris kitsch, écrivait cet auteur en 2011 dans le quotidien De Volkskrant, avant de lancer avec mépris: Paris est devenu une ville pour les gens qui se pâment devant un rien.»
Autre francophile batave, Adriaan Morriën (1912-2002) rend la découverte de Paris plus sensitive encore dans un passage que l’on peut dire initiatique et captivant de «Mademoiselle Alpacca», récit paru dans le volume Plantage Muidergracht (1988): «À la gare du Nord, je m’engage dans le métro tout comme j’ai enfilé, il y a bien longtemps, mon premier costume d’adulte […], mais ce n’est que lorsque j’émerge de terre sur les Champs-Élysées que je me trouve vraiment dans la Ville lumière. Le soir tombe: le ciel se ferme lentement comme une grande alcôve. Outre une émotion littéraire, je ressens un frisson érotique. Je vis ces premiers instants comme un émoi dans mon pénis. Je vois ma première vraie Parisienne: Fugitive beauté dont le regard m’a fait soudainement renaître. Mais celle-ci ne m’a pas même remarqué! Sous la lumière de ses propres attentes, elle ne m’accorde pas un seul regard.»
Si les Parisiens sont impitoyables envers les nouveaux venus, il arrive de surcroît que la jungle de la gare du Nord montre les dents. Le côté bourru des Français, Simon Vinkenoog (1928-2009) pouvait en parler. Cet écrivain amstellodamois considérait Paris comme un «creuset dans lequel on se débat» et où «l’on s’habitue à l’impudence des Parisiens». Alors qu’il venait de heurter par inadvertance avec sa valise un Français à la gare du Nord, ce dernier lui lança: «Ah! ces sales étrangers!» Malgré tout, l’auteur devait adopter la capitale comme «une mer à boire, c’était comme ça et pas autrement. Et aujourd’hui encore, je bois».
Jan Brokken (°1949) a été moins gâté par le sort: à la gare du Nord, il a vécu une chute humiliante. «Je me souviens, alors que je me rendais à Bordeaux, avoir voyagé avec trop de bagages. Dans les escaliers de la station de métro, pliant sous le poids, je me suis étalé de tout mon long; des centaines de Parisiens m’ont enjambé et a alors resurgi en moi cette superbe sensation qu’éprouve un gamin de la campagne: ici, je n’existe pas.» (Ik herinner mij, Je me souviens, 1988).
Le 11 décembre 1922, Georges Simenon (1903-1989) a trouvé la gare du Nord «sombre et sinistre» alors qu’il arrivait sous une pluie battante, attendu par son ami Georges Ista (1874-1939). Ce moment lui a inspiré une aversion jamais démentie pour l’endroit. Dans L’Étoile du Nord (1938), son commissaire Maigret doit résoudre un meurtre qui s’est justement déroulé dans un petit hôtel louche du quartier. Et dans Les Mémoires de Maigret (1951), le Liégeois grossit le trait: «La gare du Nord, elle, la plus froide, la plus affairée de toutes, évoque à mes yeux une lutte âpre et amère pour le pain quotidien. Est-ce parce qu’elle conduit vers des régions de mines et d’usines?»
Faisant un jour les cent pas dans cette gare, Martin Bril (1959-2009) note qu’il achète quatre histoires de Maigret pour le trajet en train qu’il s’apprête à effectuer. «L’homme qui voulait lire tous les Simenon. Ce serait un bon titre pour un roman de ce dernier», songe le natif d’Utrecht.
Les environs des gares sont, sans manquer, le terrain des parias et des laissés-pour-compte, ainsi que le prouve entre autres Abdelkader Djemaï dans son roman sensible Gare du Nord (2003). L’auteur franco-algérien nous plonge dans la vie insignifiante, désordonnée mais pas malheureuse de trois ouvriers algériens à la retraite qui crèchent dans un foyer près de la gare du Nord. Bonbon, Bartolo et Zalamite passent leurs journées autour du bistrot Chope verte, un biotope que Djemaï dépeint avec précision et intimisme.

© Anthony LE / Unsplash
En face de la gare du Nord, la façade du Terminus Nord, brasserie ouverte dans son état actuel en 1925, attire le regard grâce à ses miroirs opulents et à son «décor élégant mêlant art nouveau et art déco», ainsi que l’établissement aime à se présenter. Les écrivains y viennent pour se restaurer et profiter d’un moment de détente. Dans Een tafel voor één. Reisberichten (Une table une personne. Notes de voyage, 1990), Eric de Kuyper (°1942) écrit combien il apprécie «l’atmosphère indéfinissable» et «l’agitation excitante» qui y règnent: «J’y ai souvent mangé; […] Généralement, comme aujourd’hui, juste avant le départ du train; ou dès mon arrivée à Paris. La première ou la dernière bouchée croquée dans la pomme qui s’appelle Paris. À chaque fois, un événement qui célèbre l’arrivée ou adoucit le départ.»
De Kuyper ne se lasse pas de la célérité avec laquelle on le sert: «À peine a-t-on commandé que le plat sélectionné arrive sous votre nez. Ça grouille de serveurs, les uns plus rapides que les autres. Ils se précipitent derrière les assiettes qui volent dans les airs. Et atterrissent sur les tables pour disparaître aussitôt. Les serveurs sont des bêtes de somme et les clients des bêtes de bouffe.» Malgré une telle évocation, De Kuyper loue la qualité de la nourriture: «Ce qui est remarquable et unique, c’est que l’on s’y régale, que le personnel demeure aimable et courtois, que l’on peut manger de tout à volonté et que l’on n’a jamais l’impression d’être bousculé.» Après quoi l’auteur et cinéaste bruxellois conclut que ce «rythme de vie effréné» remonte probablement à la Belle Époque: «C’est une vitesse qu’on a désapprise, tout simplement parce qu’à l’heure actuelle, elle va toujours de pair avec une perte de qualité.»
Malgré tout, attablé un jour au Terminus Nord, De Kuyper est pris d’une légère panique lorsqu’il constate, en plein repas, que son portefeuille n’est plus dans la poche intérieure de sa veste. «Je pouvais difficilement imaginer qu’il ait été volé (même si j’ai vu Pickpocket de Robert Bresson bien assez souvent pour savoir que, dans les environs de la gare du Nord, les vols sont mis en scène selon des stratégies très subtiles, contre lesquelles même les portefeuilles les plus sécurisés sont sans défense).» Bientôt, la préposée au vestiaire le rassure. Sans tarder, l’esprit tranquille, il peut se remettre à observer le carrousel du Terminus Nord: «Les serveurs, tous les serveurs sont élégants et dansent avec animation, me souhaitant “bonne continuation”. Une expression qui peut paraître un rien comique, mais qui est tellement plus agréable à entendre que la question “Tout s’est bien passé?”.»
L’écrivain-canaille Jan Cremer (1940-2024) s’est lui aussi attablé dans un restaurant en face de la gare du Nord. Bien sûr, il y a foutu la merde, ce dont il n’a pas manqué de se vanter. En transit vers l’Espagne, il va «prendre un café au Restaurant des Flandres» avec une certaine Claudia. En raison d’un manque criant d’argent, les affamés ne peuvent que «regarder avec envie […] passer sous [leur]s yeux et nez des plats fumants, des crevettes, des moules et de délicieux sandwichs». Peu après, Cremer «craque à la vue des chopes pleines de bière fraîche que les clients, autour d’eux, boivent à grandes gorgées». Soupe à l’oignon, moules, tasses de chocolat chaud et cognac viennent compléter son sentiment d’ivresse. Qui va casquer?
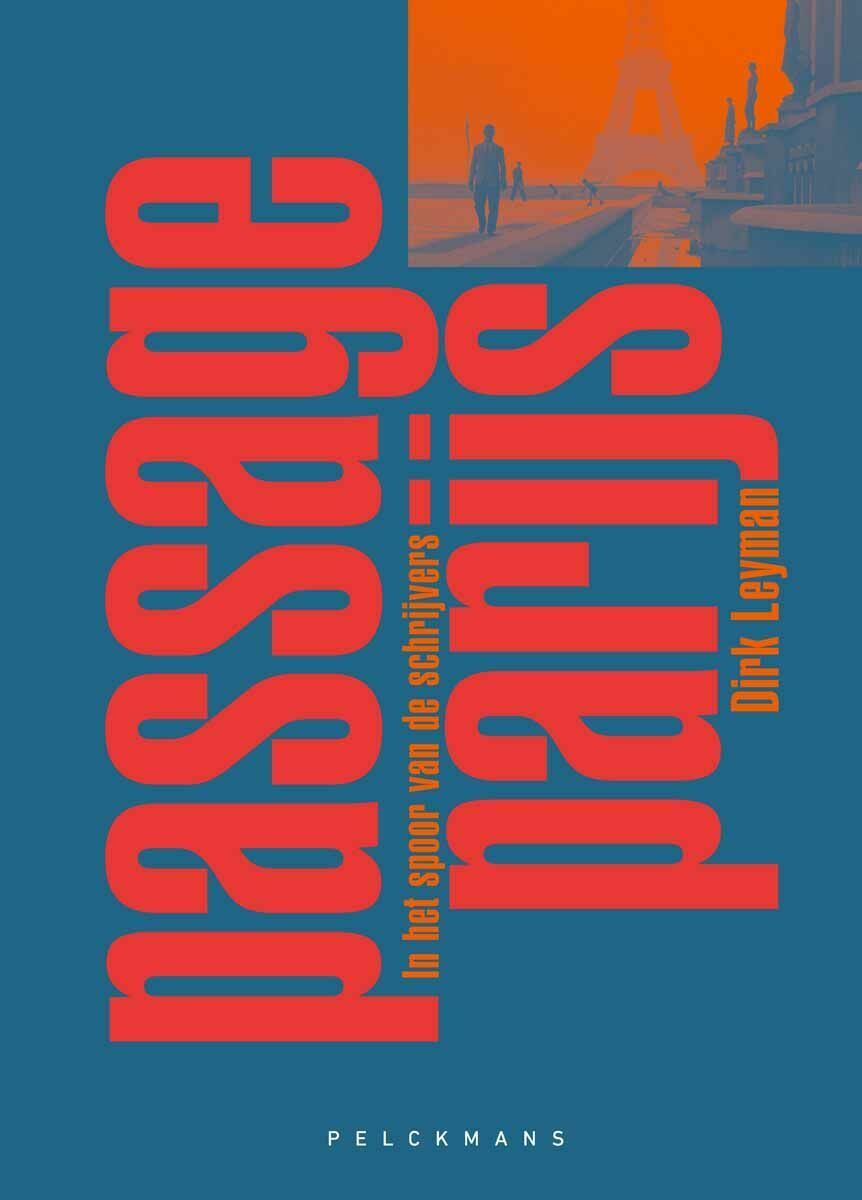
«Quand il fut temps pour nous de retourner sur les rails, j’ai dit à Claudia: “Appliquons maintenant l’article 3 du Guide de voyage de Jan Cremer. On n’a pas de quoi payer ou si on y parvenait, il nous faudrait dormir dans la rue à Barcelone demain soir. Je commence à me disputer avec toi. Tu décampes en colère. Je te cours après. Fonce jusqu’au quai 17 et attends-moi là. […] Je me mets tout à coup à lui crier dessus: “Qu’est-ce que tu crois, avec ta tronche de prétentieuse? Tu cherches à me couillonner? Avale-moi cette tarte à la cerise avant que j’la balance par terre, bon sang!” Claudia se lève, encore un peu hésitante, aussi je lui ordonne d’une voix sifflante: “Vite, dégage.” Elle obtempère. Les gens qui, autour de nous, ont suivi notre altercation la regardent avec compréhension tandis qu’elle se précipite dehors. Je reste assis, stupéfait. Jette un regard un rien gêné autour de moi. Me lève, indécis, et laisse le paquet de Gauloises vide sur la table. Puis décanille. » (Ik Jan Cremer. Tweede Boek, Moi, Jan Cremer. Tome 2, 1966)
Le chapitre “Parcours Parijs 7. Arriveren én vertrekken op het Gare du Nord: ‘Het gevoel een Franse film te zijn binnengewandeld’” (Parcours parisien 7. Arriver à la gare du Nord et en repartir: «Le sentiment d’être de plain-pied dans un film français») est tiré de l’ouvrage Passage Parijs, Pelckmans, 2025.
(1) Traduction libre






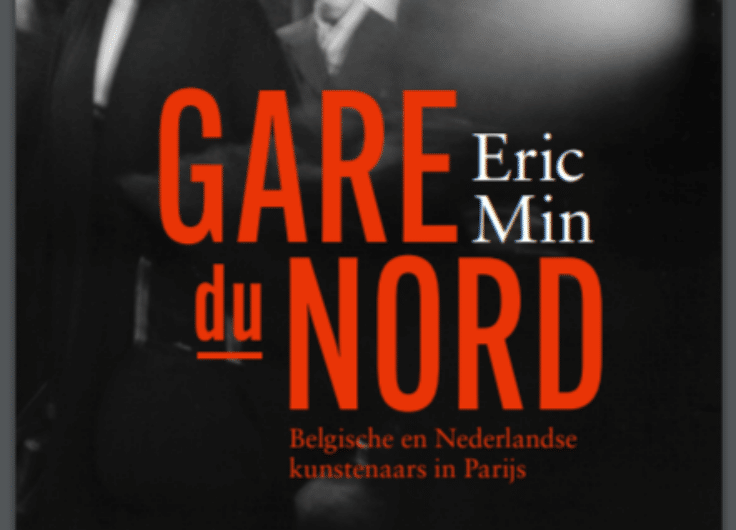





Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.