Namur, Louvain ou Molenbeek: laquelle des trois sera Capitale européenne de la culture en 2030?
Ce sont des mois mouvementés qui s’annoncent pour Louvain, Molenbeek (Bruxelles) et Namur, les trois villes qui, après l’élimination de Bruges, Gand et Courtrai, sont encore en lice dans la compétition en vue du titre de Capitale européenne de la culture en 2030. Le verdict tombera en septembre 2025.
Le 24 octobre dernier, à la KBR, la Bibliothèque royale de Bruxelles, ont été révélés les noms des trois villes appelées à poursuivre la préparation de leur candidature au titre de Capitale européenne de la culture 2030. Les jours précédents, les équipes de Gand, Bruges, Courtrai, Louvain, Namur et Molenbeek avaient défendu chacune leur projet respectif devant un jury composé de douze membres, à savoir deux Belges et dix membres étrangers, désignés par différentes instances européennes.
La manifestation à la KBR avait l’allure d’une proclamation. Au sein des délégations, la tension était à son comble. Le président néerlandais du jury, Jelle Burggraaff, a énuméré les six critères sur lesquels se fonde le jury pour évaluer les candidatures: le projet s’inscrit-il dans la vision culturelle à long terme de la ville? Quelle est sa dimension européenne? Qu’en est-il du contenu culturel et artistique? Les moyens déployés par la ville sont-ils à la hauteur de son ambition («capacity to deliver»)? Quel sera l’impact de la manifestation sur la population locale et sur la société civile? Comment seront conduits le financement et l’organisation du projet? Burggraaff s’est fait un plaisir d’entretenir cette tension. Une petite plaisanterie s’est ajoutée à son discours d’introduction, lorsqu’il a lâché «par accident» l’enveloppe qui contenait le nom des gagnants. L’ouverture de l’enveloppe a ainsi paru durer une éternité.
 En principe, les petites villes ne sont pas désavantagées par rapport aux grandes villes, mais susciter un intérêt international n'est pas évident pour les villes moins importantes. Avez-vous entendu parler de Tartu, par exemple, estonienne Capitale européenne de la culture en 2024?
En principe, les petites villes ne sont pas désavantagées par rapport aux grandes villes, mais susciter un intérêt international n'est pas évident pour les villes moins importantes. Avez-vous entendu parler de Tartu, par exemple, estonienne Capitale européenne de la culture en 2024?© Erki-Heiki Meerits / Wikimedia Commons
L’avantage des six critères et de la compétition est que les villes doivent donner le meilleur d’elles-mêmes: rallier au projet leurs infrastructures culturelles, créer des liens avec d’autres secteurs de la société, mettre en œuvre une coopération avec les communes avoisinantes ou avec des villes plus éloignées, faire mûrir des idées et thématiques afin de produire un récit cohérent. Organiser une année de festival en mettant au programme les plus grands artistes internationaux, cela ne suffit plus. Braquer tous les projecteurs sur de nouvelles et prestigieuses infrastructures culturelles –encore moins… Un fait notable au regard de l’année 2030: le lien avec le bicentenaire de la Belgique n’est évoqué nulle part, ni par le jury ni dans les projets présentés, si ce n’est au détour d’une phrase élusive du dossier de Namur.
En principe, les petites villes ne sont pas désavantagées par rapport aux grandes villes ou aux capitales. Susciter un intérêt international n’a toutefois rien d’une évidence pour les villes moins importantes. Avez-vous entendu parler de Tartu, par exemple? La ville estonienne a été Capitale européenne de la culture en 2024.
Même si le rapport définitif ne sera pas publié avant début décembre, le jury a tenu d’emblée à faire savoir, à la KBR, combien il avait été séduit par la grande qualité des propositions. Et que non, le choix ne s’est pas porté sur telle ou telle commune, wallonne, flamande ou bruxelloise, pour répondre à un besoin d’équité politique. Selon la membre belge du jury Annick Schramme, professeure de management culturel à l’université d’Anvers, ses collègues internationaux étaient à peine conscients de ces questions belges d’équité interne. Et non, Bruges n’a pas été écartée parce qu’elle a été par le passé Capitale européenne de la culture, comme l’a insinué le bourgmestre Dirk De Flauw devant la caméra de la chaîne régionale de télévision Focus-WTV.
«Confluence», «Human Nature» et «Sadaka
Dans son rapport détaillé sur le projet de la ville de Bruges The Art of Conversation, le jury critique le fait que la ville s’avance trop peu sur la manière dont elle prévoit de réinvestir l’héritage de l’année culturelle 2002. Plus généralement, le rapport estime que le projet est trop éloigné de l’ADN de la ville et d’une stratégie culturelle à long terme, et que les différents aspects n’ont pas été à ce stade suffisamment détaillés.
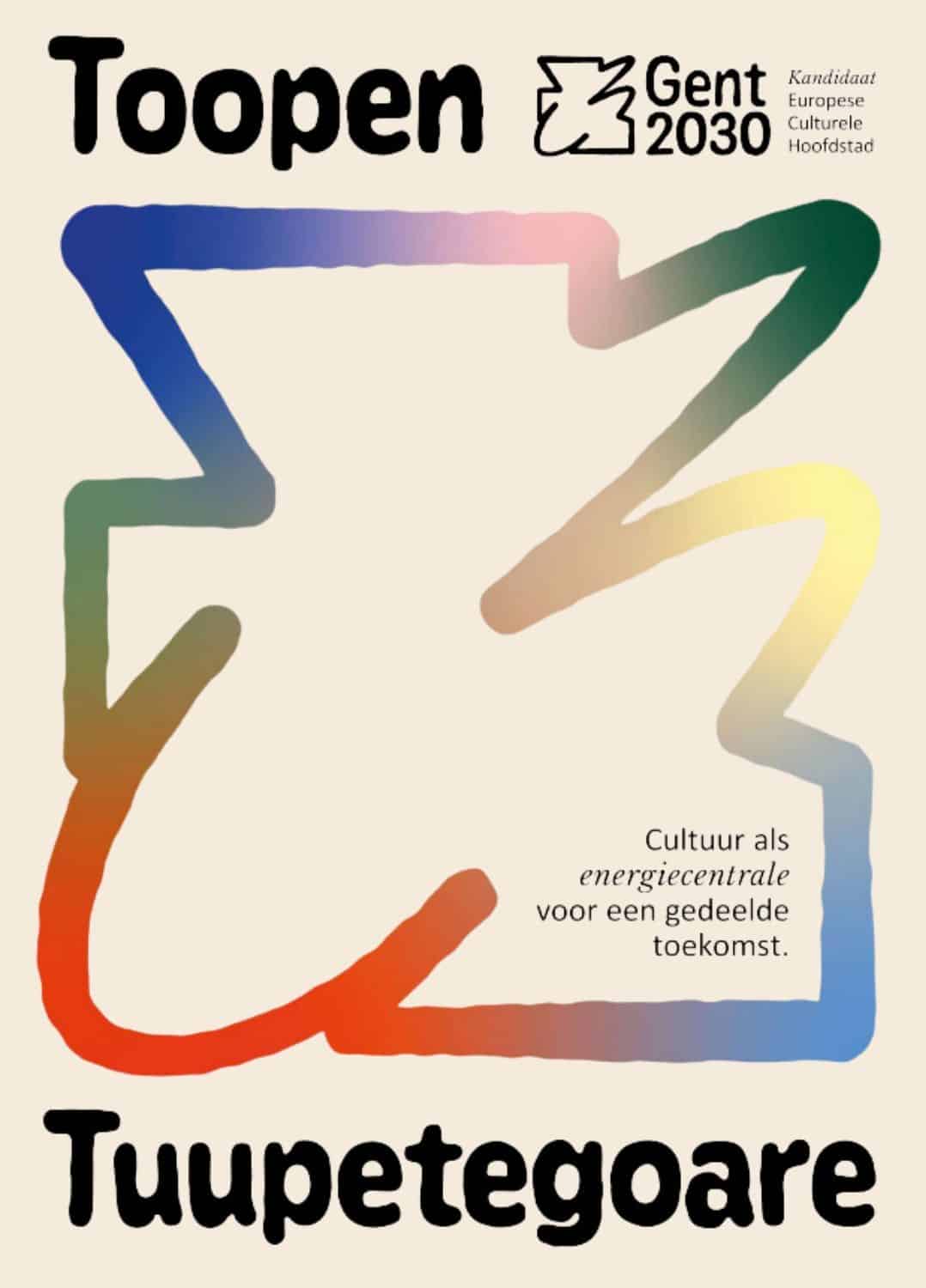 Le projet gantois d'ateliers ouverts dans lesquels les artistes joignent leurs forces à celles d’organisations, d’experts et de citoyens n'a pas été retenu.
Le projet gantois d'ateliers ouverts dans lesquels les artistes joignent leurs forces à celles d’organisations, d’experts et de citoyens n'a pas été retenu. © Gent 2030
Gand avait baptisé son projet Toopen, un mot-valise composé du grec topos (lieu) et du mot du dialecte gantois tuupetegoare (tous ensemble). Toopen, ce sont des ateliers ouverts dans lesquels les artistes joignent leurs forces à celles d’organisations, d’experts et de citoyens. Dès le départ, les Gantois avaient pris conscience du risque encouru en focalisant leur attention sur les processus et conditions à remplir pour parvenir à une vie culturelle urbaine dynamique. Pour le jury, la proposition aurait dû contenir des projets plus élaborés en l’état.
La thématique proposée par Courtrai, Just Durf, voulait évoquer l’audace («durf») d’innover, de s’attaquer aux problèmes, et insister sur le bien-être mental. Dans son rapport, le jury met en doute le fait qu’on puisse aborder un sujet aussi glissant que le bien-être mental sous une telle devise. Toujours selon le jury, outre des concepts bien développés, le projet énumère de simples «idées». Des idées qui, en l’espace d’à peine un an, auront peu de chance de se voir réalisées.
Restent donc Namur, Louvain et Molenbeek (pour Bruxelles). Dans chacun des cas, il s’agit d’une commune d’environ 100 000 habitants – toutes trois tiennent compte, cependant, dans leur candidature d’une région aux frontières élargies.
Namur est le choix le plus surprenant: la ville se considère elle-même comme le parent pauvre aux côtés de villes culturelles flamandes plus importantes
Namur est certainement le choix le plus surprenant. La ville s’est elle-même considérée comme le parent pauvre aux côtés de villes culturelles flamandes plus importantes. L’intitulé Territory of Confluences renvoie concrètement au confluent de la Sambre et de la Meuse, mais on peut aussi l’interpréter de manière symbolique. Le lien entre le monde numérique et le monde analogique est l’un des fers de lance du programme, bien que, selon le jury, Namur ait encore beaucoup de travail à fournir dans ce domaine. La ville gagne des points pour ce qui est de sa stratégie à long terme, la dimension européenne, la bonne implantation régionale ainsi que la collaboration avec les écoles et les industries créatives.
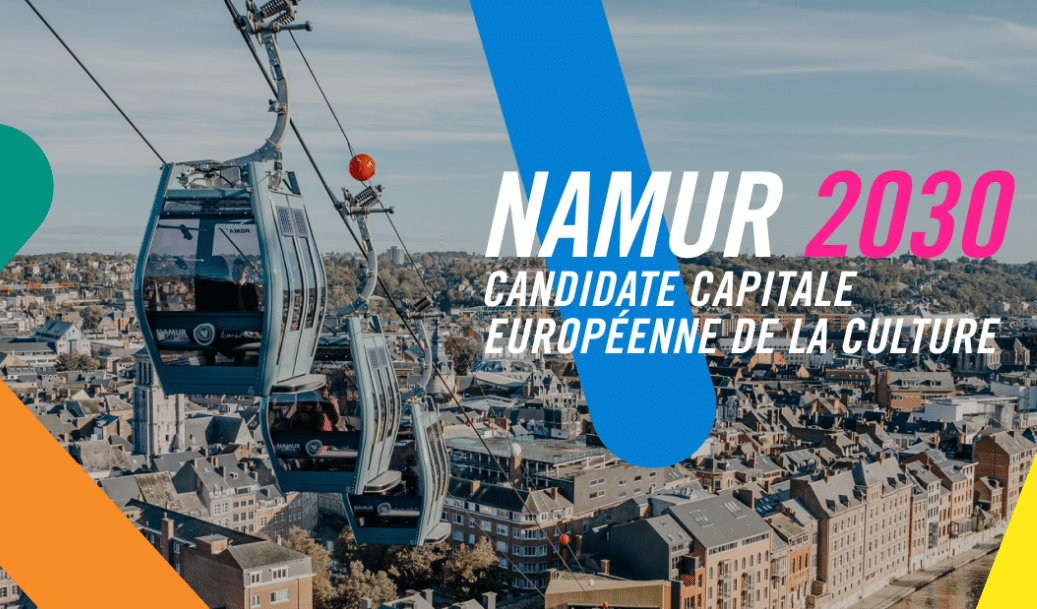
© Namur 2030
Louvain a retenu le thème Human Nature en insérant au cœur du projet le changement climatique, la polarisation de la société et l’innovation. Dans cette ville universitaire, un certain nombre d’événements ont déjà été planifiés à l’horizon 2030: l’ouverture du nouveau musée Vesalius, le nouveau festival municipal Body & Soul, la redéfinition de l’ancien hôtel de ville en une Maison européenne de la démocratie et nouvelle scène située en plein cœur historique de la ville. Dans son rapport, le jury s’est enthousiasmé, entre autres, pour «les beaux exemples de projets qui associent l’héritage local à des formes d’expression culturelles nouvelles et expérimentales». Il a également loué la forte dimension européenne, mais insiste pour que les 60 000 étudiants de la ville soient encore plus impliqués.
 Louvain a retenu le thème Human Nature en insérant au cœur du projet le changement climatique, la polarisation de la société et l’innovation.
Louvain a retenu le thème Human Nature en insérant au cœur du projet le changement climatique, la polarisation de la société et l’innovation.© BUUR / Leuven 2030
L’initiative de la candidature bruxelloise est partie de la Région de Bruxelles-Capitale, qui ne peut présenter de dossier en son nom propre. L’une des raisons du choix de Molenbeek est que la ville de Bruxelles a détenu le titre de Capitale européenne de la culture en l’an 2000. Cette nouvelle candidature a été suggérée à la suite des attentats qui ont frappé Bruxelles et Paris en 2015 et 2016. Molenbeek, où certains des terroristes avaient leur domicile, a reçu le nom de «trou de l’Enfer», bien que la commune abrite quantité de jeunes bourrés de talents. Mais aussi de nombreuses installations culturelles qui ont pris la place des anciennes friches industrielles (sans pour autant toujours entretenir de lien étroit avec la ville de Molenbeek).
Sadaka est la devise et l’argument essentiel de la candidature de Molenbeek. Le fait que des langues sans aucun lien entre elles (swahili, hébreu, arabe, ourdou) attribuent la même signification de «générosité désintéressée» au terme sadaka souligne à lui seul la dimension internationale du projet.
Molenbeek veut se rapprocher de communes comparables en Europe et ailleurs: des lieux souvent de mauvaise réputation, qui ont une population jeune et un fort potentiel. Les autres communes de la région bruxelloise sont également incluses dans le programme et chacune se verra dédier sa propre quinzaine. En attribuant une bonne note à Molenbeek, le jury a voulu saluer la manière avec laquelle le projet entend jeter des ponts entre les cultures et donner aux communautés défavorisées les moyens de s’exprimer.
Prix Melina Mercouri
Les trois communes doivent maintenant déployer tout leur talent pour donner corps à leur candidature en l’espace de quelques mois. Namur et Louvain seront très certainement aidées par la stabilité des autorités décisionnaires en place et la possibilité, en principe, de faire avancer les choses rapidement. Au lendemain de l’annonce, Louvain a publié à la KBR une offre d’emploi destinée à doter l’équipe dédiée au projet de trois nouveaux collaborateurs. Pour la candidature de Molenbeek, la situation s’avère plus compliquée. La bourgmestre Catherine Moureaux (PS) reste en poste, mais cette fois dans le cadre d’une coalition avec le PTB/PVDA. On ne peut pas dire que ce parti d’extrême-gauche soit dans le peloton de tête des formations politiques prêtes à négocier un nouveau gouvernement régional sous la houlette des libéraux du MR.
Voici venu le «money time», le moment où tout se joue. Le vainqueur est assuré d’obtenir 15 millions d’euros du gouvernement fédéral et 1,5 million de la Commission européenne, autrement dit le montant associé au prix Melina Mercouri.
Namur se tourne évidemment pour son financement principal vers la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais ces instances ne sont pas riches. Lorsque Mons a été Capitale européenne de la culture en 2015, il y a eu à cette époque beaucoup de frustration parmi les partenaires culturels des autres villes de Belgique francophone, qui ont vu à la même époque leurs subventions se réduire drastiquement.
Si Louvain se maintient, la Flandre déboursera la somme colossale de 30 millions d’euros, une contribution bienvenue, car à Louvain, on déplore une inégalité persistante dans la répartition des budgets culturels flamands
Grâce à la structure politique complexe de Bruxelles, Molenbeek peut compter sur le soutien financier de différentes autorités, mais le puzzle s’annonce compliqué. La Région wallonne sera le principal contributeur, et on espère de la Flandre une contribution à hauteur de 8 millions d’euros. Mais il y a là encore des difficultés financières. La Région bruxelloise devra consentir dans les prochaines années à d’importants efforts budgétaires, la commune démunie de Molenbeek vient donc de lancer un appel aux autorités fédérales en vue d’obtenir une aide financière. Dans son rapport, le jury s’inquiète de ce que Molenbeek ne consacre que 4,4% de son budget à la culture.
Si Louvain se maintient, la Flandre déboursera la somme colossale de 30 millions d’euros. Une contribution bienvenue, car à Louvain, on déplore une inégalité profonde et persistante dans la répartition des budgets culturels flamands. «Si l’on trace un axe allant d’Anvers à Bruxelles en passant par Malines, 91% des fonds alloués à la culture en Flandre le sont du côté ouest de cet axe. L’est du pays, avec le Brabant-oriental, la Campine et le Limbourg (qui rassemblent un tiers des Flamands) doit se contenter de 9% du budget total», dit-on à Louvain.
S’agissant des répartitions régionales, Namur, Molenbeek et Louvain dépendent chacune d’une région différente. Mais en réalité, elles se trouvent à deux pas l’une de l’autre, au centre du pays. Pour s’amuser, les Louvanistes ont ajouté à leur dossier le temps de trajet nécessaire à vélo pour rejoindre les autres villes: il ne faut qu’1h38 pour aller à Bruxelles, mais 3h14 pour aller à Namur. Un parcours sans doute un peu moins direct: la pente qui, sur la route de Namur, mène à la vallée de la Meuse est relativement vicieuse.








Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.