Une lutte entre le fils et l’écrivain : Adriaan van Dis
Quand je n’aurai plus d’ombre d’ Adriaan van Dis est le roman d’une lutte, avant tout d’une lutte entre un fils et un écrivain.
La liste des auteurs de langue néerlandaise ayant écrit un roman sur leur relation avec leur mère ne cesse de s’allonger. Un échantillon des dernières années: Tom Lanoye avec La Langue de ma mère (2011), Erwin Mortier avec Psaumes balbutiés (2013), Maarten ’t Hart avec Magdalena (2015), Arnon Grunberg avec Moedervlekken (Taches de naissance, 2016) et, en 2019, Tommy Wieringa avec Dit is mijn moeder (Voici ma mère) et Rob van Essen avec De goede zoon (Le Bon Fils).
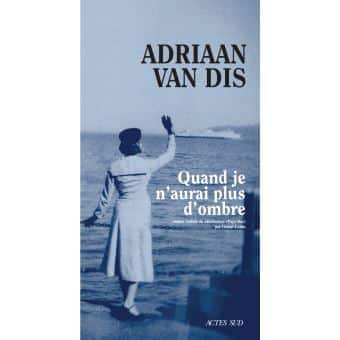
Le roman Quand je n’aurai plus d’ombre de l’auteur néerlandais Adriaan van Dis (° 1946) vient s’ajouter à la liste. Selon le jury qui a décerné le prix littéraire Libris à ce livre en 2015, il s’agit là d’un roman «extraordinaire, qui creuse de manière tragicomique vers l’essence de la nature humaine». Van Dis n’est pas étranger à l’incorporation de sa propre vie dans ses romans. Dès son premier opus, Nathan Sid (1983), puis plus tard dans Les Dunes coloniales (1999) et Fichue famille (2003), le lecteur a pu faire connaissance avec son passé aux Indes, ses trois demi-sœurs à la peau sombre et son père sévère et traumatisé aux poings durs.
Le narrateur de ce roman a quitté le domicile familial pour s’établir à Paris à l’âge de dix-neuf ans. Les visites rendues à sa mère étaient rares; le contact était principalement maintenu par d’épars coups de téléphone à la maison de repos où elle avait posé ses valises à l’âge de quatre-vingt-cinq ans. Elle ne parlait presque jamais de sa jeunesse protestante à la ferme sur le polder, des trois ans et demi passés dans un camp d’internement, de ses deux mariages et de la perte dramatique de deux époux, deux filles et un petit-enfant.
Jusqu’à ce qu’un jour, elle téléphone à son fils et exprime le souhait de revoir pour son quatre-vingt-dix-huitième anniversaire la maison où elle est née. Il doit l’y emmener, le temps presse. Durant le trajet en voiture vers sa région natale, sa langue se délie. Elle évoque la culture des betteraves et les possessions familiales, mais aussi la Première Guerre mondiale, les soldats et les réfugiés belges, puis les inondations de Zélande en 1953. Pour le fils, c’est un monde inconnu qui s’ouvre. Par bribes, son «pays du sucre», son «pays des mensonges de ma mère» dévoile ses secrets. Le passé de sa mère ressemble, à bien des égards, à un champ de bataille: la vie solitaire avec son premier mari, officier qui disparaissait pendant des semaines dans les coins les plus reculés de l’archipel indonésien et qui finirait exécuté après avoir choisi le camp des combattants de la liberté, les années au camp d’internement avec les filles, le deuxième mariage avec un ancien militaire traumatisé, le retour à une vie de solitude aux Pays-Bas.
« Bien souvent, on n’a pas d’autre choix que de tirer du bonheur de nos mensonges », soupire la mère. Les souvenirs qui refont surface jettent un éclairage nouveau sur son comportement distant, sa froideur et l’absence d’amour maternel dont le fils a souffert toute sa vie : rien que le contact physique était excès de sentimentalisme. C’est ainsi que le narrateur prend conscience qu’en fin de compte sa mère l’a façonné davantage que son père. Maintenant qu’elle est prête à dévoiler certaines choses, il lui rend visite plus souvent avec ses carnets sous le bras, malgré leurs prises de bec constantes.
C’est la double motivation de l’écrivain qui rend ce roman passionnant. D’une part, le narrateur tente de racheter une dette qu’il a en tant que fils : son ignorance du passé de sa mère, qui a toujours été occulté par celui du père. Quand il demande à sa mère pourquoi elle a gardé tout cela pour elle, elle répond: «Tu m’as jamais rien demandé.» D’autre part, le narrateur s’exprime en tant qu’écrivain et endosse ainsi un nouveau sentiment de culpabilité. Il veut non seulement dénouer le mystère de sa mère, mais aussi embellir sa vie par l’écrit – non sans y avoir un intérêt personnel. Il a en effet reçu une avance de son éditeur, un contrat attend sa signature et il va maintenant exploiter sa mère sans vergogne, comme un «vautour d’écrivain».

Mais la mère, bientôt centenaire, n’agit pas non plus de façon désintéressée. Elle lui livre l’histoire de sa vie en échange de son aide pour mourir: «Notre accord «donnant, donnant»: elle, les histoires; moi, les pilules». Il se trouve ainsi lié à un second contrat. Le lecteur, lui, se demande comment cet entretien s’est déroulé, entre le fils qui, des années durant, n’a entretenu qu’une relation téléphonique avec sa mère depuis Paris, et la mère qui s’est pratiquement tue pendant quatre-vingt-dix ans. Le roman a deux épigraphes. Celle de Karen Blixen traite ce que l’on pourrait appeler la fonction thérapeutique de la littérature: All sorrows can be borne if you put them into a story or tell a story about them.
Toutefois, Quand je n’aurai plus d’ombre n’est pas une histoire écrite en premier lieu pour pouvoir supporter une souffrance, mais plutôt une histoire qui a vu le jour grâce à une souffrance. L’auteur a trouvé dans la vie de sa mère la matière de son roman. Quand Van Dis commente explicitement ce processus d’écriture, le livre devient plat et prévisible, par exemple quand sa mère lui raconte un rêve d’un python dans la cuisine et qu’il prend «la décision de faire se tortiller le serpent sur le papier». Les considérations sur le désir d’honnêteté et la manière dont tout cela doit être couché sur papier ne sont pas non plus terriblement originales – «Non, il faut que t’écrives ça tel quel, ainsi qu’on narre une histoire, tantôt en devançant les faits, tantôt en reculant, comme dans la vraie vie», lui conseille la mère je-sais-tout.
Pourtant, ce «projet de ma mère», comme le qualifie l’auteur dans les dernières pages, est réussi. La mère est dépeinte avec nuance. Son attitude distante et son aversion du contact physique, mais aussi sa véhémence et sa conscience politique, brossent le portrait convaincant d’une femme apeurée dans l’ombre d’un mari abusif. Le ton ironique rend les émotions digestes. Le rapprochement entre la mère et le fils éveille, de part et d’autre, compréhension et compassion en même temps que rancœur et acrimonie. En outre, le narrateur dit avoir plus en commun avec sa mère qu’il ne le voudrait, y compris les mauvais côtés et l’angoisse.
 Adriaan van Dis.
Adriaan van Dis.© C. Schutte.
Ce livre est une réussite avant tout par la manière dont le narrateur se découvre et se met à nu en racontant sa mère. Par les souvenirs et les anecdotes, l’histoire traite autant de sa mère que de lui. La froideur de l’une est le besoin de chaleur de l’autre. Quand ils vont voir ensemble la maison de naissance de la mère et que celle-ci discute avec un descendant des anciens locataires de son père, le narrateur se sent étranger.
Le lecteur observe sa jalousie: «L’homme qui avait pris le bras de ma mère aurait pu être son fils, tant ils semblaient proches». Quand, un peu plus tard, il pose sa main sur l’épaule maternelle, «elle la chassa d’un grelottement». Sa place dans l’arbre généalogique reste celle d’une pomme qui bringuebale tout en-dessous, d’un bâtard sans progéniture. C’est lui qui colore les histoires de sa mère et tente ainsi de l’atteindre: «T’entends, lui dis-je, tu parles en moi et moi en toi.» Cette dynamique se manifeste principalement dans les récits qui ne prennent pas la forme d’un monologue de la mère, mais celle d’un jeu de voix qui ne permet pas de savoir si c’est la mère qui a raconté l’histoire de cette manière au fils, ou si c’est le fils qui la reconstruit et l’interprète.
Quand je n’aurai plus d’ombre est le roman d’une lutte. Celle du fils avec la mère, celle de la mère avec ses souvenirs des camps, ses mariages et la mort qui approche – «Vieillir, c’est aussi une guerre», dit-elle -, celle de l’écrivain avec l’histoire qu’il raconte. Mais, avant tout, Quand je n’aurai plus d’ombre est l’histoire d’une lutte entre un fils et un écrivain.





