Naviguer dans la jungle des opinions
Sur les bancs de l’université en Belgique, l’autrice flamande Sarah Meuleman avait appris à garder son opinion pour elle. Son choc culturel a été grand lorsqu’elle a poursuivi ses études aux Pays-Bas où donner son avis est encouragé, voire attendu. Un apprentissage positif selon elle, mais est-ce que toutes les opinions se valent pour autant, surtout à l’heure des réseaux sociaux?
Nerveuse, j’essaie tant bien que mal de me dissimuler derrière mon pupitre. Notre professeure, éminente spécialiste de la littérature, répète une seconde fois sa question impossible: «Que penses-tu de Kant»? Je m’étrangle presque. Les néons m’éblouissent, une salle de cours remplie de Néerlandais et d’un Sud-Africain me fixe. Tout le monde semblait avoir l’une ou l’autre opinion sur le philosophe allemand, mais mon opinion à moi, c’est que je trouve la situation gênante, voire extrêmement embarrassante.
Mon master aux Pays-Bas s’assimilait à un véritable choc culturel. Le contraste avec l’université belge où j’avais étudié jusque-là ne pouvait être plus grand. L’adage qui prévalait à la faculté de lettres de l’université de Gand était le suivant: apprendre par cœur et recopier tel quel. On y recevait un syllabus de quelques centaines de pages, qu’on s’attelait ensuite à reproduire le plus fidèlement possible. Laisser transparaitre le moins possible de soi dans ses réponses était la garantie d’obtenir la note la plus élevée.
 La Faculté des Lettres de l'université de Gand (Blandijn)
La Faculté des Lettres de l'université de Gand (Blandijn)© UGent
Une telle approche s’accorde parfaitement avec l’attachement des Belges pour la retenue. Depuis ma plus tendre enfance, on m’a inculqué l’importance de la modestie, indissociable d’un profond respect pour les grandes figures intellectuelles. Un professeur, dans ce cadre, est perçu comme une autorité quasi divine, un oracle prophétisant derrière son pupitre. On ne lui pose de question que si elle est d’une pertinence exceptionnelle. Le silence est de mise. Envie d’émettre ton opinion? C’est pour plus tard, quand tu seras grande.
Revenons aux Pays-Bas et à ce tout premier cours où ma professeure m’a si gentiment demandé de partager mon avis sur Emmanuel Kant. J’avais bien lu les sept pages de lecture obligatoire avant le cours –comme le prescrivait la tâche–, et pourtant, comment pourrais-je, moi, une jeune femme d’à peine une vingtaine d’années, oser formuler un avis sur l’un des philosophes les plus influents de l’époque moderne? La question m’apparaissait tout à fait déraisonnable et déplacée, voire irrespectueuse envers une figure aussi imposante.
 Le Bungehuis où se trouve la Faculté des Lettres de l'unversité d'Amsterdam
Le Bungehuis où se trouve la Faculté des Lettres de l'unversité d'Amsterdam© Jane 023 / Wikimedia Commons
Mes camarades d’études néerlandais n’y voyaient en revanche aucun problème. Le cliché selon lequel les «Hollandais» parlent haut et fort et toujours prompts à donner leur avis ne me semble pas totalement infondé. Depuis que j’ai déménagé à Amsterdam, je comprends désormais pourquoi: les opinions y sont perçues différemment.
Mon silence, que je considérais jusqu’alors comme respectueux, était vu comme une faiblesse au sein d’une université néerlandaise. Mon hésitation, comme de la lenteur d’esprit. Ma retenue, comme un manque de courage. Dès le premier jour à l’université d’Amsterdam (UvA), j’ai compris qu’il me faudrait remettre en question cette pudeur belge profondément enracinée. Au fond, formuler une opinion, aussi embryonnaire soit-elle, est-ce vraiment acte irrespectueux?
Le temps a passé. Je suis devenue grande. Je constate aujourd’hui que c’était tout le contraire: les syllabus d’Amsterdam paraissaient peut-être enfantins comparés à ceux de Gand, mais les discussions en amphithéâtre étaient stimulantes et pleines de maturité. Si j’ai bien retenu une chose de mes années d’études aux Pays-Bas, c’est la suivante «ton opinion a de la valeur».
Mon silence, que je considérais comme respectueux, était vu comme une faiblesse au sein d’une université néerlandaise
C’était du moins ma conviction profonde jusqu’à ce que le monde littéraire s’enflamme il y a quelques années au sujet d’une nouvelle de Pim Lammers. L’auteur de livre pour enfants devait écrire le poème pour la Semaine de la littérature jeunesse. Or les réseaux sociaux se sont saisi d’une nouvelle écrite par Lammers plusieurs années plus tôt dans laquelle y adopte le point de vue narratif d’un pédophile… pour dénoncer ce comportement.
Cela n’a pas empêché les accusations de pédophilie à son égard. Les opinions se sont bousculées sur les réseaux sociaux, chacun y allant de son commentaire, sans retenue et souvent avec des mots incisifs, tous profondément convaincus de la justesse de leur avis. Cette polémique a amené Lammers à ne pas participer à Semaine de la littérature jeunesse, victime de la «cancel culture». Dans un tel contexte, pouvons-nous encore défendre que chaque opinion a de la valeur?
 Pim Lammers
Pim Lammers© Singel uitgeverijen
Auparavant, l’expertise dans un domaine représentait un avantage, une compétence acquise sur laquelle on pouvait bâtir toute une carrière. De nos jours, les institutions et instituts qui incarnaient autrefois l’autorité deviennent chaque jour un peu plus silencieux. Ils se retrouvent submergés par le flot incessant de bavardages de la machine à opinions en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Je repense avec une certaine nostalgie à l’approche de l’université belge, qui dissuadait les opinions. Un seul syllabus; une seule vérité. Les opinions viendraient plus tard. C’était si calme. Tout à coup, je me demande s’il est réellement judicieux de donner à une étudiante de vingt ans l’impression qu’elle puisse être capable de produire un avis sensé sur Kant après la lecture de sept pages seulement. Ne s’agit-il pas d’une situation comparable à celle de ces soi-disant critiques littéraires qui se sont déchainés contre Lammers sur Twitter sans avoir (ou à peine) lu ses poèmes et ses récits?
Le terme context collapse (ou «effondrement du contexte») est une expression qui prend tout son sens dans le discours produit autour du cas Lammers: en l’absence de contexte, les faits ne peuvent plus être correctement compris ni interprétés. Revenons à Kant: combien doit-on avoir lu du philosophe pour éviter de tomber dans le piège d’un contexte insuffisant? Cent pages? Cinq cents? Ou bien… sept?
Je dois admettre qu’il est très inconfortable de constater qu’une approche qui m’a tant émancipée puisse simultanément avoir des conséquences aussi néfastes à l’échelle de la société. Mais son alternative –apprendre par cœur et répéter mécaniquement– n’est pas meilleure pour autant. Dissuader les jeunes de former et formuler leur propre opinion ne les prépare pas à affronter la réalité des réseaux sociaux, qui les incitent constamment à s’exprimer dans l’immédiat sur des sujets complexes.
 Dissuader les jeunes de former et formuler leur propre opinion ne les prépare pas à affronter la réalité des réseaux sociaux
Dissuader les jeunes de former et formuler leur propre opinion ne les prépare pas à affronter la réalité des réseaux sociaux© Visuals / Unsplash
Aujourd’hui, la machine à opinions 24/7 tourne de plus en plus vite. La véritable expertise consiste désormais à naviguer intelligemment à travers cette jungle d’opinions. Il s’agit d’un défi de taille. Il ne sera jamais trop tôt pour former la jeune génération à la pensée critique. Et cela, aucun syllabus de mille pages ne pourra le faire de manière efficace.
À l’étudiante flamande silencieuse que j’étais à l’époque, j’aimerais dire aujourd’hui: aie une opinion. Lis plus –bien plus!– que sept pages. Formule avec soin. Garde l’esprit ouvert. Et peut-être la plus grande leçon de toutes: veille à ne plus jamais t’effacer.




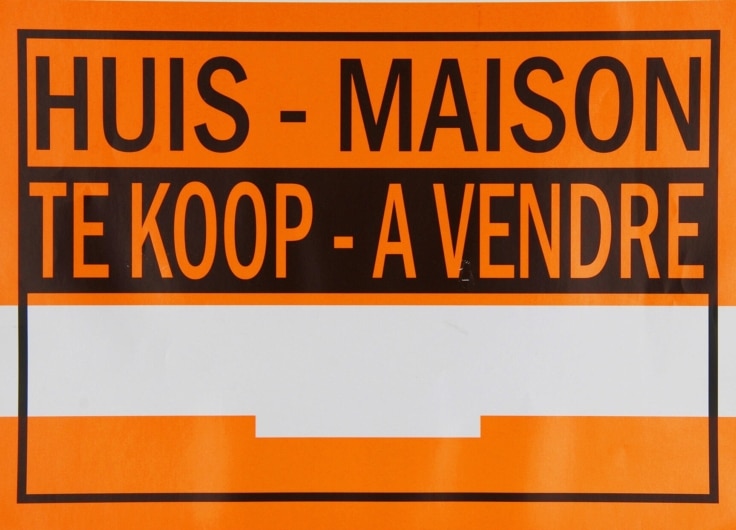






Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.